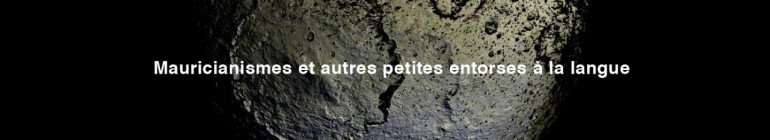Nénène / nénaine.
Nom féminin.
Nounou, bonne d’enfants.

“Julie et sa nénène, Grand Baie – 1979”
Extrait de Mauriciens, Yves Pitchen
“Qu’est-ce que tu radotes alors? S’il y a une nénène pour veiller l’enfant qu’est-ce que tu fais toi? Pas dire moi ki to veilles la nénène qui veille ton petit-enfant!”
(Jean-Claude Antoine, Week-End, 15 novembre 2010.)
“Deux fois Émile Galantie l’avait sauvé de ses créanciers. Il lui servait même une rente, moitié je crois dans l’espoir de calmer ses velléités subversives, et moitié pour qu’il pût entretenir la vieille nénène qui avait la garde de son fils, cet André dont nul ne tenait à hériter.”
(Loys Masson, Le Notaire des Noirs (1961), page 15.)
“Tant pis donc pour ceux assez sadiques pour faire bosser un cuistot ou une nénène au-delà de 22 heures, après huit heures de boulot “normal”, un dimanche ou un jour férié où tout le monde (mais pas les mères de famille…il faut bien que quelqu’un se sacrifie dans une maisonnée) est censé pouvoir s’amuser et même participer à la liesse nationale.”
(Yvan Martial, L’Express, 23 octobre 2006.)
“Les passagers les plus «difficiles» sont, sans conteste, les Mauriciens de l’étranger, qui se croient «propriétaires» d’Air Mauritius et qui sollicitent des services qu’ils ne feront jamais sur une autre compagnie étrangère. Un exemple : celui qui va se moucher sur le fauteuil et qui va exiger que vous veniez essuyer cela. Ou encore celle qui va exiger que vous changiez la couche de son bébé. «Vini, vini, ou mem nenenn, pa vre ?»”
(La Vie catholique, 12-18 janvier 2007.)
“Sa pension ne suffisant pas, sa mère travaille « kom nenen » pour subvenir aux dépenses de la famille.”
(Week-End/Scope, 25 août 2010.)
Selon divers auteurs (Baker & Hookoomsing, Robillard, Beniamino, Nallatamby, Carpooran), le mot est issu du français dialectal. Baker et Hookoomsing (1987) précisent que le mot est attesté en créole depuis 1878 et mentionnent un nène signifiant “marraine” ainsi qu’un ninnin signifiant “nourrice” (l’origine de ces mots est peu claire dans leur dictionnaire). Pour sa part, Carpooran (2011) mentionne nénaine, du français dialectal, sans plus de précision.

Yves Pitchen, Mauriciens, éditions Husson, 2006.
On retrouve le mot à la Réunion, où il a la même signification qu’à Maurice (cf. Michel Beniamino, en lien sur la partie droite de cette page). Quelques exemples relevés sur Internet :
“Notes de l’auteur : Le mot nénène signifie en créole de la Réunion, bonne d’enfants ou nourrice. Autrefois, il s’agissait souvent de jeunes filles, parfois d’enfants, pauvres ou orphelines, placées par leur propre parenté dans des familles aisées. Elles y étaient préposées à la surveillance des enfants mais participaient aussi à toutes les autres tâches ménagères. Elles demeuraient au sein de la famille jusqu’à leur mariage. Parfois elles n’en partaient jamais. On pourrait dire aujourd’hui qu’elles étaient exploitées mais dans le contexte social de l’époque, cela évitait à bien des enfants l’humiliation d’être des « ramassés » par l’Assistance Publique. Avec l’avènement des lois sociales, les nénènes sont devenues des employées de maison et ont perdu leur rôle affectif..”
(Nicole Baret, blog, 23/10/09.)
“Ce développement a ouvert la voie du travail aux femmes. On pourrait dire que celles-ci sont passées du statut de la “nénaine” à celui de l’institutrice ou de la caissière de magasin, en l’espace de deux générations.”
(Témoignages, 1er juillet 2004.)
Par glissement de sens — et puisqu’il a souvent dû être demandé à la nounou de donner un coup de main pour les tâches ménagères —, le mot nénène est aussi arrivé à signifier “femme de ménage, servante”. En deuxième définition Robillard donne ceci :
Nénène [2] – n.f. cour. gén. neutre ‖ Bonne à tout faire. La nénène pourra peut-être s’occuper de faire les lits. Étymol. : généralisation de nénène [1].
Une telle acception se retrouve dans cet extrait de roman :
“Là, plus personne ne pouvait nous surprendre puisque je n’ai jamais eu d’employée de maison (Aunauth dit « employée de maison » au lieu de « femme de ménage » ou du traditionnel « nénène » usité chez nous ; ça semble un peu prétentieux dans sa bouche, on ne saurait dire pourquoi.)”
(Marie-Thérèse Humbert, A l’autre bout de moi (1979), page 357.)
Ou dans cet article de journal :
“Les patients en colère indiquent que la situation est toujours la même, ces derniers mois, à cet hôpital. « Kan mank docter, bizin employ lot docter. Nu patients ki souffer. Ou kroir, mo plaie pe soupiré, mo kapav resté assizé lor ban enn zourné ? », s’exclame une habitante de Cité Martial. Et les autres d’ajouter : « ici, nenenn ki donn lord. Zot ki fer la loi are ou. Kan demandé ki pe arrivé, ki fer tardé, bann la dir, attan ou tour ».”
(Week-End, 15 février 2009.)
Ѫ
(PS — Les photos en noir et blanc sont tirées de Mauriciens, un livre du photographe Yves Pitchen.)
____________
Mise à jour du 25 août 2011.
Le 24 août 2011 à 16:37, Leveto a posté un commentaire dans lequel il évoquait un livre où il était possible de trouver de très intéressantes informations à propos du mot nénène, un mot signifiant “marraine” dans certains dialectes des régions de l’Ouest de la France comme la Vendée. Le livre, intitulé Richesses du français et géographie linguistique, a été écrit sous la direction de l’universitaire André Thibault avant d’être publié en 2008. Aux pages 61 et 62 il est possible de lire ce qui suit :
6.10.1.6 Nénène
Nénène n.f. « marraine » (FEW)
« Il prétexta une visite à sa tante Émilienne […]. [T]u t’intéresse enfin à ta nénène ? Elle était sa marraine. » (Vigne, 149)
Le régionalisme lexical limité au registre familier ne figure pas dans les sources générales et différentielles consultées, mais a été retenu en Vendée pour le discours dialectal (Svenson 1959 nénèn ; Arantèle 1983 nenène). Pour le français, Pierre Rézeau enregistre la variante nêne, plus répandue dans l’Ouest de la France (cf. Rézeau Ouest s.v. nêne). Le diatropisme est issu d’une famille lexicale des dialectes gallo-romans du Sud : il s’agit d’une innovation régionale (créée en milieu soit dialectophone soit français), non pas par redoublement à partir de nêne, mais par assimilation régressive de la consonne initiale [m] aux deux autres consonnes [n] à partir d’un type menène/ménène/mènène (issu de men-, cf FEW VI/1, 702a s.v. men-). Voir aussi les variantes dialectales mnit (Vendée), mni, mnin, meni (Centre-Ouest). Un entretien avec l’écrivain* a permis de préciser que la variante, ressentie comme un diminutif de nêne, est tout à fait usuelle dans son entourage familial.
Dans Vigne, le régionalisme apparait également dans le récit (Vigne, 150). En parlant à Angéline par contre, Philbert utilise le mot marraine, qui est plus approprié ici parce que plus distancié (Vigne, 154 ; cf. aussi Claudine, 92 2x, 119). Le régionalisme rendu inéquivoque par un commentaire métalinguistique qui suit immédiatement le particularisme (‘elle était sa marraine’), semble être attribué à la langue plutôt parlée et sert à souligner l’affection que porte la locutrice à son neveu.
* L’auteur dont il est question ici est Yves Viollier, un Vendéen ayant écrit un certain nombre de romans à forte connotation régionale. Trois de ses livres ont été analysés par l’auteur de la partie sur les régionalismes de l’Ouest (Inka Wissner) et la citation figurant au début de l’extrait ci-dessus est tirée du roman Les Pêches de vigne (1994).
__________
Mise à jour du 21 octobre 2011
Notre correspondante Alsace nous fait parvenir une photo d’elle enfant, dans les bras de sa nénène, ainsi qu’une photo d’une sienne cousine soutenue elle aussi par la nénène (une autre ?).


C’est ainsi que sur la même page cohabitent petite-fille et grand-mère, par-delà les générations — de nénènes. (Voir les commentaires ci-dessous.)
__________
Mise à jour du 14 avril 2012
Un livre écrit par une Américaine du Sud (et non par une Sud-Américaine, ce qui ne serait pas exactement la même chose) a pour sujet principal la condition de nénène dans des familles blanches d’une ville du Mississipi. Il se trouve être dans le droit-fil de ce billet-ci.

Dans The Help, Kathryn Stockett évoque avec talent les relations — parfois ambigües — qui ont pu exister, dans un ancien État confédéré, entre des employeurs blancs et leurs employés de maison noirs.
__________
Mise à jour du 19 mai 2013
“Lindsay et Laurencia étaient déjà là quand Bénie, à cinq ans, est arrivée de Londres avec ses parents. Laurencia est devenue sa nénène* et l’a suivie comme son ombre jusqu’à l’âge de l’école, plus attentive que sa propre mère.”
(Geneviève Dormann, Le Bal du dodo (1989), page 18.)
* l’italique est de l’auteure (française), laquelle précise au sujet du mot nénène, dans une note en bas de page : “bonne d’enfant, nourrice”