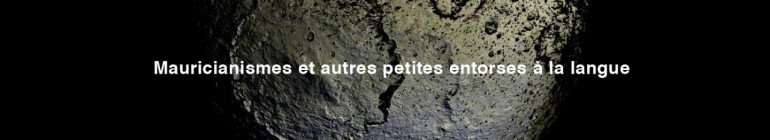Zangarna.
Nom masculin.
Païen, mécréant. (Bon à rien.)
Ƶ
 “L’appellation chrétienne est encore plus gênante. Qui est chrétien, aux yeux de Dieu, et qui ne l’est pas ? Qui est plus aimé de Dieu du zangarna baptisé en bonne et due forme, avec parrain, marraine, dragées, brioches et robe blanche, ou les plus sincères des adorateurs de Ram, de Shiva, de Vishnu, qui connaissent autant les Evangiles que les Upanishads et le Mahabharata, des croyants clamant plusieurs fois par jour et de toute la force de leurs haut-parleurs la grandeur du Dieu Unique, le Dieu d’Ibrahim, de Yacoob et d’Issac, et qui se souhaitent : Salaam alaikhoum ! comme le Christ nous dit : «[La] Paix soit avec vous» ?”
“L’appellation chrétienne est encore plus gênante. Qui est chrétien, aux yeux de Dieu, et qui ne l’est pas ? Qui est plus aimé de Dieu du zangarna baptisé en bonne et due forme, avec parrain, marraine, dragées, brioches et robe blanche, ou les plus sincères des adorateurs de Ram, de Shiva, de Vishnu, qui connaissent autant les Evangiles que les Upanishads et le Mahabharata, des croyants clamant plusieurs fois par jour et de toute la force de leurs haut-parleurs la grandeur du Dieu Unique, le Dieu d’Ibrahim, de Yacoob et d’Issac, et qui se souhaitent : Salaam alaikhoum ! comme le Christ nous dit : «[La] Paix soit avec vous» ?”
(Yvan Martial, La Vie catholique, 4 au 10 mai 2007.)
“Mais gare aux zangarnas comme toi, Quincois ! Si tu as un grigri sur toi, jette le vite à la mer, dès que tu as aperçu une baleine ; sans ça, elle te poursuivra jusqu’à ce qu’elle ait coulé ton bateau !”
“ZANGARNA. – (Corruption de Jaggernaut): boudhiste, adepte des rites de Jaggernaut et, par extension, païen, non-chrétien – voire, mauvais chrétien”
(Savinien Mérédac, Polyte (page 99), 1926.)
“J’ajouterai, mieux les préparer pour mieux les contrôler. Pour soi-disant ne pas laisser les gens — perçus comme des zangarna — qui se séparent de leur confession sans spiritualité.”
“zangarna : personne ou gens vivant sans foi religieuse.”
(Christian Némorin, Une Île inachevée, 2008.)
“ZANGARNA. Païen, homme sans religion, impie ; par extension, hérétique. ETYM : Jaggurnaut, ville de l’Inde […].”
(Robert Furlong et Vicram Ramharai, Panorama de la littérature mauricienne: la production créolophone. Des origines à l’indépendance, 2007.)
“Wi, mo dakor; akoz bannla nou dan pens.
Bann sal Zangarna! Payen! Zanfan Satan!”
(Dev Virahsawmy, Karay So (pou Gérard Sullivan), 9 long poem, 2006.)
“Parski mo lapo maron,
Parski mo seve nwar-drwat,
Parski mo al sivala
To dir mo enn zangarna.
Parski nou pa koz parey,
Parski mo met langouti,
Parski mo manz farata
To dir mo enn bachara.”
(Dev Virahsawmy, novembre 2007.)
“When some Mauritians choose to call their Hindu neighbour Zangarna, they unconsciously pronounce the name Jugannath, the Lord of the Universe.”
(Sookdeo Bissoondoyal, A Concise History of Mauritius, 1965.)
“Anou ekout enn parol dan segon liv Martir Izrael (7,1-2.9-14)
[…]
9 Zis avan li rann so dernie soupir, deziem frer- la dir lerwa: «To enn zangarna, to pe tir nou lavi lor later azordi, me akoz nou fidel ar lalwa, lerwa liniver pou resisit nou, pou donn nou lavi eternel.»”
(La Vie catholique, 05 au 11 novembre 2010.)
Ƶ
L’expression est relativement rare (elle ne figure d’ailleurs pas dans le Diksioner morisien de Carpooran), ce qui expliquerait sans doute pourquoi le sens qui s’y attache peut varier d’un locuteur à un autre. Pour une partie des gens, le terme zangarna est lié à la religion et s’utilise pour parler de celui qui ne croit pas en Dieu, ou dont la pratique religieuse laisse à désirer — autrement dit un mécréant (un mauvais croyant), un misbeliever, un apikoros. Pour une autre partie, un zangarna est “un bougre qui ne fait rien de sa vie”, un type qui se laisse aller et qui se moque de ce que la société peut penser de lui — autrement dit un traîne-savate, un jean-foutre, un bon-à-rien. Cette deuxième acception dérive certainement de la première. Le fait d’être un mécréant étant moralement condamnable, le terme possède une connotation suffisamment péjorative pour être employé en tant que terme de reproche dans d’autres contextes, d’où l’extension ou le changement de sens. On remarquera toutefois que dans le 8e et dernier exemple d’utilisation ci-dessus, le passage biblique en créole “to enn zangarna” provient du texte suivant (cité plus bas dans l’article de La Vie catholique) : “tu es un scélérat” — scélératesse se rattachant sans nul doute au fait d’être un bon-à-rien.
●

Baker & Hookoomsing, Dictionnaire du créole mauricien, page 341.
Selon MM. Baker et Hookoomsing, l’expression vient du nom d’une divinité hindoue dont le temple principal se trouve dans la ville de Puri en Orissa, sur la côte est de la péninsule indienne, au bord du golfe du Bengale. Dans cette ville est vénéré Jagannath, lequel est une manifestation de Krishna, donc de Vishnou. La statue du dieu, peinte en noir, est dotée de grands yeux, d’une grande bouche et de bras courts. Au cours de la grande fête annuelle qui a lieu au mois de juin ou juillet — le Ratha Yatra —, trois énormes chariots (ratha) sont construits pour abriter et transporter Jagannath, son frère et sa sœur. Cette fête a lieu dans une atmosphère de grand enthousiasme, de nombreux pélerins venant à Puri afin d’avoir la bénédiction de la vue du dieu (son darshan). La foule en liesse et la vénération prodiguée à la trinité composée de Jagannath, de Balarama et de Subhadra ont suffisamment frappé les Européens — surtout les plus puritains et les plus empreints de préjugés — pour que ceux-ci associent le culte de Jagannath à la plus condamnable des formes d’idolâtrie.

Procession de Jagannath à Puri.
En 1806, un missionnaire écossais, Claudius Buchanan, a assisté au festival des chariots et en a donné un compte rendu empreint de critique. Ce “reportage” figure sous forme de journal dans ses Christian Researches in Asia, publiées en 1811, la condamnation morale du puritain clergyman Britannique envers ces rituels qu’il réprouve apparaissant à chacune de ses phrases ou presque :
“I have seen Juggernaut. […] The idol called Juggernaut has been considered as the Moloch of the present age; and he is justly so named, for the sacrifices offered up to him by self-devotment, are not less criminal, perhaps not less numerous, than those recorded of the Moloch of Canaan.”
“The idol is a block of wood, having a frightful visage painted black, with a distended mouth of a bloody colour.”

Le mépris des Anglais pour les croyances et les coutumes indiennes se sont exprimées — y compris par écrit — tout au long du XIXe siècle, et même au-delà (cf. les commentaires de Winston Churchill sur Gandhi en 1930 ou sur ce qu’il aurait qualifié de “beastly religion”). Il n’est donc pas particulièrement étonnant de voir que, impressionnés par des rites qu’ils ne comprenaient pas et qu’ils désapprouvaient, les Européens aient utilisés les mots indiens attachés à ces cultes pour en faire des expressions connotées négativement, d’où “juggernaut” en Grande-Bretagne ou “zangarna” à Maurice.

Oxford English Dictionary (Shorter), third edition.
Longtemps avant le peintre Xavier Le Juge (1939, 1952), François Chrestien a traduit des fables de La Fontaine en créole. C’est ainsi que dans ses Essais d’un bobre africain (1822 1ère édition, 1831 2e édition, 1869 3e édition), en traduisant Le Rat qui s’est retiré du monde, pour faire plus “couleur locale” il transforme l’exotique mot “derviche” en “prêtre zanguerna” :

À Maurice on trouve un certain nombre de patronymes dérivés du nom de Jagannath, le Seigneur de l’Univers. Au cours du XIXe siècle, probablement à l’arrivée des immigrants indiens à Port-Louis, ces noms, transcrits en alphabet latin, ont reçu des graphies diverses, comme on s’en rend compte aujourd’hui encore.

Extraits de l’annuaire téléphonique (2014).
Il ne nous a pas semblé, cependant, que ces noms aient jamais été associés au mot mauricien zangarna, ni même au mot anglais juggernaut. S’il existe une parenté étymologique entre eux, cela ne s’est jamais concrétisé ni dans les esprits ni dans le langage. À tout seigneur, tout honneur.

Jagarnath Lane