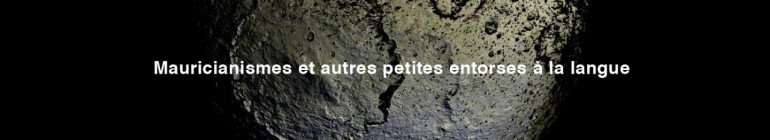Canette.
Nom féminin.
Bille.

Le mot canettes pour parler des billes pourrait provenir d’un usage régional français. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française (1863-1873), a plusieurs entrées pour ce mot, et à la première d’entre elles il donne quatre définitions. La quatrième est la suivante :
(ka-nè-t’) substantif féminin
(…)
4° Nom, dans quelques provinces, de la bille dont les enfants se servent pour jouer. XVe s.
Dans Le Parler normand, mots et expressions du terroir, Patrice Brasseur a en effet une entrée pour canette signifiant bille.
 (Toutes les photos sont cliquables.)
(Toutes les photos sont cliquables.)
A la page 44 on apprend que dans l’Orne, le sud-est du Calvados et le sud de l’Eure le mot canette est employé pour parler de la bille pour les jeux des enfants :

Cependant, le genre donné par l’auteur est à l’opposé de celui mentionné par littré, lequel est le même que celui utilisé à Maurice (une canette) — à se demander s’il ne s’agit pas là d’une erreur typographique. Il serait sans doute nécessaire de demander à des Normands utilisant (ou ayant utilisé) ce mot pour parler de billes s’ils disent (ou ont dit) « un canette ». Je ne suis pas linguiste, mais j’imagine que si les mots peuvent se transformer au fil du temps, il leur arrive bien plus difficilement de changer de genre. (Peut-être Marie-Lucie ou quelqu’un d’autre pourrait nous en dire davantage à ce sujet.)
Littré, toujours lui, dit encore ceci :
Bourguig. caner, jouer sa bille, sa canette.
(“Bourguig. » pourrait ici être l’abréviation de « bourguignon ».) Mais cela n’explique guère comment on est passé de la canette signifiant petite cane, ou bobine de fil d’un métier à tisser ou d’une machine à coudre, ou encore bouteille de bière, à la bille. La façon qu’a eue Littré de regrouper ses définitions suggère que le mot utilisé pour parler de la bille proviendrait de l’animal. A titre indicatif, dans d’autres parties de la Normandie on parle d’une canique (voir plus haut, photo de la page 45).
A Maurice, comme dans d’autres pays j’imagine, il existe des noms spécifiques pour parler des différentes variétés de billes. Du temps que je traînais dans la cour de récréation canette en main (ou dans la poche), nous avions les « ordinaires », transparentes avec trois couleurs torsadées à l’intérieur, les « palais ourite », en porcelaine opaque blanche et un motif torsadé tricolore en surface, les « palais dilo », entièrement transparents (sans aucun motif), colorés (vert, bleu) ou pas, les « palais de terre » qui étaient des billes en terre cuite, ou les « palais de fer » qui n’étaient que des billes de gros roulements à billes reconverties. Il est à noter que les billes de roulements à billes n’étaient jamais appelées « canettes ». Les canettes ne servaient qu’à jouer.

Des "ordinaires", ou "locales".
Il y a quelques temps de cela, j’ai appris de la bouche d’une fillette d’une dizaine d’années qu’aujourd’hui les enfants appelaient « locales » les canettes que nous nous appelions « ordinaires ». En pensant à « local » en tant que mauricianisme (voir la liste), j’ai été obligé de sourire.

Des "palais ourite", ou "perroquets".
Il paraît qu’aujourd’hui les palais ourite s’appellent des « perroquets ». O tempora…

Un "palais dilo" de nouvelle génération (plus nacré que les nôtres).
Je suppose que le mot « palais » devrait lui aussi être mis dans la liste de mauricianisme, même si semble-t-il il n’est plus guère utilisé aujourd’hui. J’ai toutefois un doute quant à la graphie que j’aurais dû adopter : palais (palace en anglais) ou palet (puck ou quoit en anglais) ? Il s’agit pour une large part de ce qu’en français on appellerait un calot, si je me souviens bien de mes lectures, c’est-à-dire une bille sortant quelque peu de l’ordinaire, généralement de plus grosse taille que les autres (voir les deux plus gros palais ourite sur la première photo de cette page).
Je me rappelle deux jeux de billes, un peu trop vaguement hélas. Il y avait la « poursuite », qui comme son nom l’indique n’était qu’une poursuite, le perdant étant celui qui était touché le premier, et il y avait le « triangle ».
Le triangle, lui, pouvait se jouer à plus de deux, si j’ai bonne mémoire, chacun mettant une ou plusieurs billes dans un triangle tracé sur le sol et lançant une autre bille vers une ligne située à une certaine distance du triangle. Celui qui arrivait le plus près de la ligne commençait. Il se mettait derrière la ligne et essayait de sortir des billes du triangle ou à s’approcher de ce dernier en lançant sa propre bille à jouer. Les autres faisaient de même. Après le premier lancer, chacun jouait à tour de rôle, au ras du sol, en poussant sa bille a jouer avec le pouce après avoir avancé d’un empan. Chaque bille qu’on avait sorti du triangle devenait la sienne. Mais je ne me souviens plus de ce qui se passait lorsque sa bille à jouer restait dans le triangle. Perdait-on son tour ? Fallait-il repartir derrière la ligne ? Une âme charitable ayant moins perdu la mémoire que moi pourrait-elle m’aider à la retrouver ?