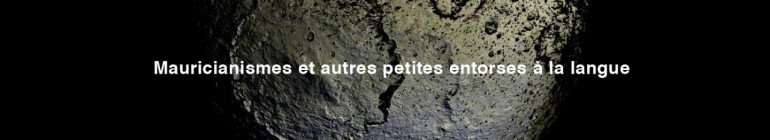À partir du XVIIe siècle le passage de la planète Vénus entre la Terre et le Soleil a revêtu une importance particulière pour les astronomes terriens. Mesurer, en différents points du globe terrestre, le temps que prenait cette planète pour passer devant le disque solaire ainsi que l’heure du passage devait permettre de connaître la distance entre la Terre et le Soleil.  La connaissance du rayon de l’orbite terrestre avait une importance particulière en ce qu’il s’agissait d’une distance servant d’étalon pour mesurer les distances astronomiques. Cette distance de référence séparant la Terre du Soleil porte le nom d’unité astronomique, une unité encore utilisée de nos jours.
La connaissance du rayon de l’orbite terrestre avait une importance particulière en ce qu’il s’agissait d’une distance servant d’étalon pour mesurer les distances astronomiques. Cette distance de référence séparant la Terre du Soleil porte le nom d’unité astronomique, une unité encore utilisée de nos jours.
C’est en 1639 en Angleterre que le premier transit de Vénus fut observé par un astronome de génie mort à l’âge de 22 ans, le pasteur Jeremiah Horrocks, évènement qu’il avait lui-même prédit à l’encontre des calculs du grand Kepler. Il apparut, suite notamment aux travaux d’Edmond Halley — le 2e directeur de l’observatoire de Greenwich —, que le transit de Vénus permettrait de connaître cette fameuse distance Terre-Soleil. C’est ainsi que le passage de Vénus devant le soleil au cours du mois de juin 1761 fut attendu avec de grands espoirs par les astronomes européens. Organisèrent alors des expéditions l’Angleterre et la France, puissances maritimes en guerre, mais aussi la Russie, la Suède ou les Pays-Bas.
 Après force discussions côté français, il fut décidé que, entre autres scientifiques, un prêtre franc-maçon, l’abbé Alexandre-Guy Pingré, serait envoyé sur une minuscule île de l’océan Indien, l’île Rodrigues, alors habitée par environ 70 personnes, et que Guillaume Le Gentil serait expédié vers une autre possession française, Pondichéry, au Sud de l’Inde — ce qui allait lui occasionner des déboires restés célèbres.
Après force discussions côté français, il fut décidé que, entre autres scientifiques, un prêtre franc-maçon, l’abbé Alexandre-Guy Pingré, serait envoyé sur une minuscule île de l’océan Indien, l’île Rodrigues, alors habitée par environ 70 personnes, et que Guillaume Le Gentil serait expédié vers une autre possession française, Pondichéry, au Sud de l’Inde — ce qui allait lui occasionner des déboires restés célèbres.
L’expédition de Pingré fut un demi-échec, les conditions météorologiques rodriguaises ayant été capricieuses le matin du 6 juin 1761. Le chanoine ne put observer le Soleil que par intermittence, comme le raconte un autre prêtre catholique, Amédée Nagapen, dans un livre un peu fourre-tout publié en 2004 :
Toutefois, les scientifiques tôt levés constatèrent qu’il pleuvait de tous côtés et qu’un vent violent soufflait sur l’endroit. Pire, au lever du soleil, une chape d’épais nuages bouchait le soleil. Or, l’entrée de Vénus sur le disque du Soleil devait se faire peu après le lever du Soleil “à 6h34”. Assurément, les deux scientifiques se sentirent immédiatement envahis d’un sentiment de profonde frustration. En conséquence, ils manquèrent les deux premiers contacts entre la planète Vénus et le Soleil. Fort heureusement, par la suite, le ciel s’éclaircit et ils purent effectuer quelques utiles observations. (…)
(Amédée Nagapen, Le Transit de Vénus, 2004.)

En ce qui concerne l’astronome Le Gentil envoyé vers Pondichéry, sa frustration fut probablement bien plus grande que celle de son collègue : les Anglais ayant pris la ville, il ne put débarquer et dut rentrer à l’île de France (île Maurice) sans avoir pu effectuer ses observations le jour J. Il resta dans la région pendant les 8 années qui le séparaient du prochain transit de Vénus, celui de juin 1769. Pondichéry ayant été rendue à la France, il s’y rendit en mars 1768 et y bâtit un observatoire, tout en s’intéressant à ce qui l’entourait, y compris l’astronomie indienne. Hélas, le jour du transit, le 3 juin 1769, le mauvais temps l’empêcha de voir le soleil alors que les jours précédents avaient été dégagés, de même que le suivant. Découragé, il entreprit le voyage de retour vers la France, qu’il avait quittée en 1760. Après avoir été malade, il s’embarqua pour l’île de France en mars 1770, où il dut rester en convalescence jusqu’au le 19 novembre de cette année, date à laquelle il quitta Maurice sur le navire l’Indien, en même temps que Bernardin de Saint-Pierre. À l’île Bourbon (la Réunion), le 30 décembre, l’Indien dut prendre le large à cause d’un cyclone et subit des avaries alors que les collections d’histoire naturelle réunies par Le Gentil furent perdues. Le bateau dut regagner Port-Louis. Finalement, en mars 1771 l’astronome trouva place sur un navire espagnol qui le débarqua à Cadix en août 1771, ce qui lui permit de regagner Paris par la route, onze ans et demi après son départ. En France, on le donnait pour mort, l’Académie des Sciences ne le comptait plus parmi ses membres, ses héritiers s’étaient partagé ses biens (il perdit même son procès quand il tenta de les récupérer) et sa femme s’était remariée. C’est sans doute ce que dans l’île de France d’aujourd’hui on appellerait “être mofine”.
C’est aussi pour observer le transit de Vénus de 1769 que le navigateur James Cook se rendit pour la première fois de l’autre côté de la Terre, à Tahiti. Il y bâtit un fortin sur une péninsule qui, depuis, porte le nom de pointe Vénus, un toponyme qui n’est pas inconnu des Rodriguais, comme nous le verrons plus loin. Les observations de Cook connurent des résultats mitigés, non pas à cause des guerres ou de la météo comme dans le cas du pauvre Le Gentil, mais à cause du phénomène connu sous le nom de goutte noire. Il s’agissait d’une aberration optique tendant à déformer l’image de Vénus peu avant son contact avec le disque solaire et peu avant sa sortie du disque solaire, ce qui faussait la mesure de l’instant auquel le transit commençait et finissait.

Pour l’observation du transit de 1874, de meilleurs instruments allaient aider à réaliser des mesures plus précises. Cette année-là, le transit de Vénus put être photographié pour la première fois. Le nombre d’expéditions éparpillées sur la surface de la terre fut particulièrement élevé, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, les États-Unis ou la Russie dépêchant des équipes d’observateurs entre autres à Rodrigues (une fois encore), à Maurice, à la Réunion, à Saint-Paul, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, en Chine, au Japon, en Sibérie, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, aux Kerguelen (cet archipel isolé et battu par les vents du sud de l’océan Indien recevant la bagatelle de trois missions, une américaine, une anglaise et une allemande).

À Rodrigues, l’Amirauté britannique déploya les grands moyens, construisant un observatoire astronomique sur les ruines d’un fort disparu, à un endroit qui allait par la suite être connu sous le nom de pointe Vénus, pointe située entre la “capitale” Port-Mathurin et l’Anse aux Anglais, sur la côte Nord de l’île. C’est ainsi qu’une seule observation astronomique se déroulant à une date bien précise influença la toponymie pour plusieurs siècles, voire davantage, tout comme cela s’était passé 105 ans plus tôt à Tahiti.

Plusieurs postes d’observation furent établis à Rodrigues, les Anglais ayant prévu de mesurer le phénomène non seulement de “l’observatoire principal” de pointe Vénus mais aussi de la pointe Coton et de l’îlot de l’Hermitage. Selon le récit du lieutenant Neate de la Royal Navy, responsable de l’expédition astronomique et observateur principal à la pointe Vénus, “by the kind permission of Mr. Bell, the resident magistrate, the observatory was surrounded by policemen, and no one was allowed to approach.” Sans doute la curiosité des autochtones risquait-elle de perturber le bon déroulement du transit. Les mesures furent un succès complet cette fois-ci, ce qui a peut-être fait plaisir à Pingré au Paradis, alors même qu’à Maurice et à la Réunion le mauvais temps rendait impossibles les observations. Dans son compte rendu le lieutenant Neate raconta en ces mots le moment où Vénus toucha le Soleil :
I did not see the planet till it had (apparently) broken into the Sun’s limb. Instantly when I saw the notch on the Sun’s limb I also saw the remaining segment of the planet showing in strong relief against the dark space beyond, and surrounded by an exceedingly faint annular haze. The following limb of the planet also appeared bright, like a very young moon. This appearance I have attempted to show in Fig. 1, Plate XIII. I used an Airy eye-piece, power 152, for the observation of all phenomena. The dark glass I used was a neutral tint achromatised wedge. The first phenomenon recorded by me was that of Circular or apparent Contact at 11h.51m.24s.5 by the Equatorial Clock, as shown in Fig. 2. The formation of a dark ligament between the limbs of the Sun and Venus followed instantaneously. It was as if, after Circular Contact, a piece of Venus was being drawn out by the Sun. The breadth of this ligament was apparently one-fourth (approximately) of Venus’ diameter.

Les observations de 1874 permirent d’estimer la parallaxe du Soleil à 8.8 secondes d’arc, ce qui veut dire que le rayon de la Terre serait vu sous cet angle pour un observateur malencontreusement placé au centre du Soleil. Sachant le rayon de notre planète égal à 6370 km, distance mesurable avec un bon décamètre, et qu’à l’école on nous a appris que la tangente de l’angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent, il en ressortait que la distance entre Rodrigues et le Soleil avoisinait les 149 millions de kilomètres. QED.
 “Il portait un short tellement lâche que, de temps en temps, quand il était assis le genou en l’air, on voyait ses graines.”
“Il portait un short tellement lâche que, de temps en temps, quand il était assis le genou en l’air, on voyait ses graines.”