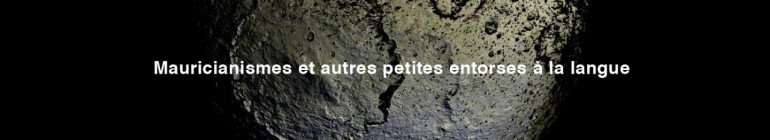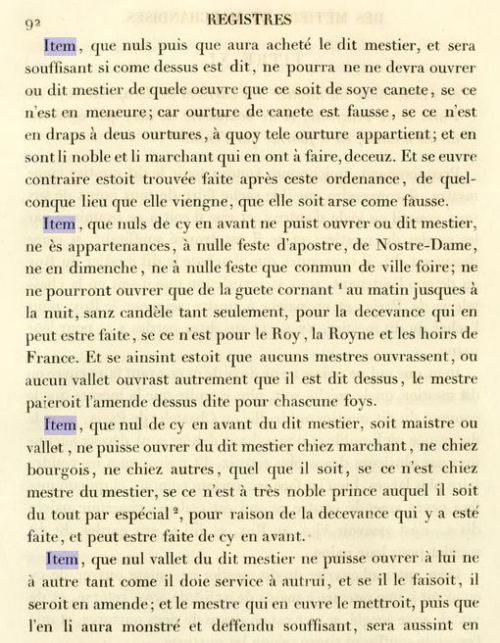Une anecdote savoureuse…
Ce jour-là, lors de la visite du terrain sur lequel une maison doit être construite, il est question du tracé de la limite de propriété (généralement appelée balisage). La dame est anglophone à l’origine (mère anglophone [juin 2016]) mais, ayant épousé un Mauricien, elle a dû vivre à Maurice depuis au moins vingt ans, tant et si bien qu’elle s’exprime d’une façon somme toute très locale, quand bien même son origine anglaise transpire çà et là dans son accent. Le terrain est plutôt rectangulaire mais, à proximité d’un des coins, son balisage part un peu en biais. Parlant un français tout à fait correct de la part d’une personne n’ayant probablement pas pratiqué cette langue dans ses plus jeunes années, la dame explique que cette partie du terrain est “en sulcan”. Ah ! quel bonheur d’entendre cela !
En créole il existe une expression signifiant “en biais”, “en diagonale”, “de travers”. Cette expression est “an silkan”. Dans le Diksioner Morisien de Carpooran, il est question de “edgewise, diagonally”. Baker et Hookoomsing, eux, mentionnent “sur can, en diagonale” et, de façon peu claire, parlent d’un 2e sens : “dans une direction diagonale de.” Quant au dictionnaire de Ledikasyon Pu Travayer, il parle pour sa part de “crooked, askew, squiffy”.

Diksioner Morisien, page 975.
Passons sur le mot crooked (tordu), qui ne me semble pas vraiment convenir, alors que squiffy (éméché, un peu saoul) me semble complètement hors sujet, et concentrons nous sur ce que disent MM. Baker et Hookoomsing, propos repris d’ailleurs en partie par le professeur Carpooran. Tous deux — ou plutôt tous trois — parlent d’une expression française “sur can” ou “en dessus le can”, dans laquelle, on peut le supposer, le mystérieux mot can rime avec camp, quand et chant et non avec canne ou Strauss-Khan.
Ce mot — can — ne figure pas dans le Petit Robert, où l’entrée canada fait suite à camus. Il ne figure pas non plus dans le Grand Larousse. Le Dictionnaire historique de la langue française ne connaît pas d’entrée à can, pas plus que le très-complet Trésor de la langue française. Qu’en conclure ? Que le mot can est une invention de nos lexicographes locaux, une affabulation ?
Carpooran, comme on peut le voir plus haut, parle d’un “français dialectal” dont serait issue l’expression créole, tout en se gardant bien de préciser quel est le dialecte en question et de quelle façon il serait à l’origine de cette expression. Mais peut-être s’agit-il d’une prononciation régionale du mot chant ? On gardera en tête à ce sujet que la consonne douce ch- — prononcée [ʃ], ou “sh-” — du mot chant correspond au son [k] dans d’autres langues (canto en italien, en portugais et dans d’autres langues latines, cantus en latin) ou en français même (cantate, cantatrice, cantique).
Et on gardera aussi en tête que le chant d’un objet relativement plat comme une lame de parquet, une brique ou un livre est sa partie la moins large, aussi appelée tranche. Poser une brique “sur chant”, ce n’est pas la poser à plat comme on le fait couramment, mais sur le côté. Idem pour les lames de parquet, qu’on pose parfois de façon à ce que ce soit la tranche de chaque lame qui soit visible, plutôt que le plus grand côté plat. Peut-être est-ce à ce chant-là, qui serait ou aurait été prononcé [kɑ̃] dans certaines régions, que MM. Baker, Hookoomsing et Carpooran font référence ?
En admettant que ce soit bien le cas, en admettant donc que “an silkan” ait bien l’origine que lui prêtent les auteurs cités, on comprendrait toujours mal pourquoi l’expression française “sur chant”, prononcée donc “sur can” en l’occurrence, laquelle a trait au fait de poser un objet parallélépipédique sur son petit côté plutôt qu’à plat, aurait pu donner l’expression créole “an silkan” signifiant “en biais, de travers”. Car en posant la chose sur (le) chant, on la pose droit, pas en biais ni de travers. Mais la langue, lorsqu’elle évolue ou donne naissance à une autre, ne suit pas forcément le chemin de la logique.
Ce qui était particulièrement réjouissant dans l’usage de cette expression créole par la dame construisant sa maison résidait d’une part dans le fait qu’une personne d’origine étrangère utilise une expression qu’un certain nombre de Mauriciens ne connaissent même pas, et d’autre part qu’elle le fasse en effectuant au passage une hyper-correction fort amusante. Comme il est bien connu que les sons -u du français ont été transformés en -i en créole (la musique = lamizik, la lune = lalinn, tout nu = touni), il arrive que lors d’une tentative de francisation d’un mot créole certains mettent un -u pour remplacer un -i, même lorsque cela ne se justifie pas.