Roussaille.
Nom féminin.
Eugenia uniflora. Fruit rouge, rond et côtelé, pouvant ressembler à un potiron en miniature, produit par un arbuste ou un petit arbre appelé roussailler (ou roussaillier). Le fruit, légèrement acidulé, possède une saveur caractéristique.
Originaire d’Amérique du Sud, le roussaillier appartient à la famille des Myrtacées (tout comme le jeanmalac, le jamblon, le jambosse, le niaouli, le bottle brush et de nombreuses autres espèces présentes à Maurice). Il appartient en outre au même genre que les “cerises” locales (Eugenia brasiliensis), cerises qu’on a pu voir ici il y a trois ans. Si les roussailles ne sont jamais appelées “cerises” à Maurice, à la Réunion elles portent avant tout le nom de “cerises à côtes” ou de “cerises de Cayenne”, l’appellation “roussaille” y ayant cependant été attestée (cf. par exemple Eugène Jacob de Cordemoy, Flore de l’île de la Réunion (1895), page 424, où il est dit que le nom vulgaire d’Eugenia uniflora, arbuste du Brésil naturalisé à la Réunion, est “roussaille, cerise”). Dans des pays de tradition plus anglophone on peut la trouver sous le nom de “Surinam cherry” (cerise du Surinam) ou de “Brazil cherry” (cerise du Brésil), voire de “pumpkin cherry” (cerise potiron).
●
“Sur la berge des bassins, Mukesh a mis en terre des plantes pour l’embellir. Mais comme il ne manque pas d’idées, il y a une année, il a créé un verger sur un terrain d’un arpent. Il y cultive tous les fruits qu’on peut trouver à Maurice. Même ceux qui sont en voie de disparition, comme la vavangue, le cœur de bœuf ou la roussaille.”
(L’Express, 14 mai 2007.)
“La 15e édition de la Fête des Fruits a lieu ce dimanche au Jardin Balfour à Beau-Bassin. Activité annuelle de la mairie des villes-sœurs, cette fête connaît, à chaque édition, un grand succès d’affluence et d’ambiance. C’est, notamment, l’occasion pour la jeune génération de découvrir des fruits rarissimes disparus des marchés traditionnels et autrefois en abondance dans nos bois et bosquets tels la ‘pomme jacquot’, la ‘bibasse’ ou encore la ‘roussaille’.”
(Week-End, 7 février 2005.)
“Le restaurant offre aux clients un véritable havre de paix. Il est ouvert sur un immense jardin accessible au public où le gazon côtoie une multitude d’arbres fruitiers méconnus, à l’instar du combava, du fruit à pain ou encore de la roussaille.”
(Scope, 6 juillet 2011.)
“‘Il y a très peu d’enfants qui connaissent la pomme jacquot, la roussaille ou le lucuma, même la prune locale est méconnue, parce que quand vous allez au marché, vous voyez surtout des fruits importés telles la pomme, la poire et l’orange”, affirme Ameenah Gurib-Fakim. L’auteur nous fait goûter, sur 190 pages, au jamrosat, à la framboise marronne, au jamblon, à la grenade.”
(L’Express, 17 janvier 2006.)
“Les auteurs de l’étude ont en premier lieu été particulièrement étonnés de constater que si restreinte soit-elle (0,75 hectare), leur surface d’échantillonnage a permis de recenser 56 % de toutes les espèces ligneuses indigènes jusqu’alors répertoriées dans ce type de forêt. Ils ont aussi pu retrouver une espèce endémique qu’on n’avait pas vue depuis 150 ans, et ils ont découvert une nouvelle espèce d’arbre endémique dans la famille des Eugenia (bois clou, espèce proche du [?] roussaille cultivé).”
(Le Mauricien, 11 janvier 2013.)
“The few remaining areas of native vegetation are badly degraded through the invasion by exotic plants such as “piquant loulou » (Acacia nilotica), jamrosa (Syzygium jambos), bois d’oiseaux (Litsea glutinosa), aloes (Furcraea foetida), vieille fille (Lantana camara) and ravenale (Ravenala madagascariensis). A number of other plants potentially threaten native vegetation, including poivre marron (Schinus terebinthifolius), roussaillier (Eugenia uniflora) and Chinese guava (Psidium cattleianum).”
(National bio-diversity strategy and action plan 2006-2015, Chapter 6 (Rodrigues), site du gouvernement.)
●

Diksyoner kreol morisyen (1987), page 280.
Le mot roussaille pourrait être une corruption du mot français groseille, le groseillier étant un type de plante originaire des régions tempérées de l’hémisphère nord n’existant pas à Maurice (Ribes spp.). C’est du moins la possibilité qu’évoquent MM. Baker et Hookoomsing dans leur dictionnaire du créole, comme on peut le voir dans l’extrait ci-dessus tiré de la page 280 de l’ouvrage, ces auteurs suggérant par ailleurs de se tourner vers l’Inde, où, en portugais, le fruit (ou un fruit similaire du genre Eugenia lui aussi) aurait été appelé groselha peruviania.
À première vue il peut paraître difficile de croire que le mot rousaille puisse provenir du mot groseille, les prononciations semblant par trop différentes. Mais en essayant oralement de “corrompre” la prononciation du mot groseille, en gardant de surcroît à l’esprit qu’une influence portugaise a pu s’immiscer dans l’opération, alors on finit par se dire que la roussaille est peut-être un rejet, voire un rejeton, de la groseille. C’est en outre ce que mentionne le Dictionnaire historique de la langue française (édition de 2010), ouvrage de référence écrit sous la direction d’Alain Rey et dans lequel, de façon inattendue, on peut trouver une entrée à propos des roussailles mauriciennes (et — ne soyons pas excessivement chauvins — bourbonnaises) : “ROUSSAILLE n. f. (1804) semble être la déformation de groseille”.
Le DHLF précise par ailleurs que la transformation du mot groseille en roussaille a pu être influencée par le mot roux, ou plutôt son féminin rousse, mot renvoyant consciemment ou inconsciemment à la couleur rougeâtre du fruit.  Selon ce qui figure dans ce dictionnaire contemporain, le mot serait attesté — par écrit donc — à partir de 1804. On le retrouve bien en 1880 dans cette savoureuse Étude sur le patois créole de Charles Baissac, publiée à Nancy en France, savoureuse aujourd’hui encore quand bien même ce livre vieux de cent trente ans peut fleurer le paternalisme d’une société cloisonnée dans ses préjugés. Baissac, évoquant un temps où il était exilé loin de Maurice, parle de la saveur exquise qu’il aurait alors trouvée aux plus “contestables” des fruits du pays natal, citant à cette occasion les vavangues et les roussailles — des mots qu’il s’abstient de mettre en italique ou entre guillemets :
Selon ce qui figure dans ce dictionnaire contemporain, le mot serait attesté — par écrit donc — à partir de 1804. On le retrouve bien en 1880 dans cette savoureuse Étude sur le patois créole de Charles Baissac, publiée à Nancy en France, savoureuse aujourd’hui encore quand bien même ce livre vieux de cent trente ans peut fleurer le paternalisme d’une société cloisonnée dans ses préjugés. Baissac, évoquant un temps où il était exilé loin de Maurice, parle de la saveur exquise qu’il aurait alors trouvée aux plus “contestables” des fruits du pays natal, citant à cette occasion les vavangues et les roussailles — des mots qu’il s’abstient de mettre en italique ou entre guillemets :
Le roussailler est mentionné à la page 143 de l’Hortus Mauritianus, l‘“énumération” du botaniste Wenceslas Bojer imprimé à Maurice en 1837, lequel précise alors qu’il est “presque naturalisé” dans l’île. Plus ancien que le livre de Baissac et celui de Bojer, le Dictionnaire classique d’histoire naturelle (tome XIV), publié en 1828, parle de la roussaille et du roussailler en précisant qu’on les trouve à Maurice et à la Réunion :
Dans l’Encyclopédie Méthodique, dans le sixième tome consacré à l’agriculture, publié en 1816, à la page 194 il est question de la roussaille, laquelle, de façon assez singulière, est donnée comme étant synonyme de jambosier :
Le Nouveau cours complet d’agriculture théorique et pratique, volume 7, paru en 1809, parle lui aussi de la roussaille (page 400), par ailleurs appelée à cette occasion “jambosier de Micheli”, pour dire qu’elle est cultivée “à la Chine”. (Rappelons que l’espèce est d’origine sud-américaine.)
En 1803, dans le tome XII du Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts (page 242), on retrouve notre roussailler, appelé là aussi “jambosier de Micheli”, arbre qui, selon les auteurs, pousse aux “aux Grandes-Indes, à la Chine, et dans l’Amérique méridionale” :
Par ailleurs, dans Le Jardin des Pamplemousses (1983), Guy Rouillard mentionne le botaniste François Péron qui fit partie de l’expédition Baudin vers l’Australie, laquelle relâcha par deux fois à Maurice (1801 à l’aller, 1803 au retour). Et c’est à cette occasion que Péron visita le jardin des Pamplemousses et chanta les louanges de Nicolas Céré qui, dit-il, a su naturaliser un nombre prodigieux d’arbres et d’arbustes, parmi lesquels il cite “l’arbre de Cythère, le latanier, la roussaille, l’arbre à suif, l’arbre à thé…”
Il semblerait par ailleurs que la culture de la roussaille se soit répandue dans le monde jusqu’au Maghreb, car dans le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (publié entre 1872 et 1877) on trouve le mot roussaillier, un arbre poussant en Algérie selon l’auteur, qui à cette occasion cite le Journal Officiel du 26 novembre 1874 :
ROUSSAILLIER. (rou-sa-llé, ll mouillées) s. m.
Espèce d’arbre à fruit de l’Algérie.
Journ. offic. 26 nov. 1874, p. 7813, 2e col.: Le roussaillier, aux jolies cerises cannelées, à la pulpe aigrelette et un peu térébenthinée.
●
À ma connaissance à Maurice on ne trouve que des roussailles rouges, mais il en existe qui sont d’un pourpre très foncé, presque noir, comme des jamblons. On peut en voir un exemple ici.
Toutefois Ameenah Gurib-Fakim de l’université de Maurice mentionne une variété foncée et sucrée (voir l’extrait de son livre ci-dessus). Pas plus que je n’ai entendu qui que ce soit dire “goussaille” comme le signalent Baker & Hookoomsing dans leur dictionnaire en tant que prononciation alternative, jamais je ne suis tombé sur une roussaille violette et douce. Mais un jour, peut-être…
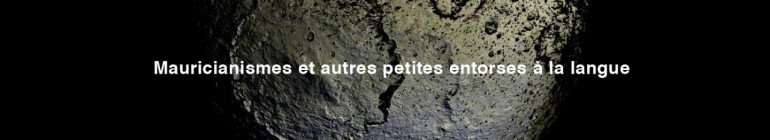


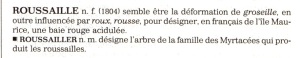







J’aime pas la roussaille, c’est acide à vous faire grimacer !
Siganus, votre article est remarquable et mérite bien sûr d’être relu à tête reposée.
Néanmoins, je peux d’ores et déjà signaler que le nom brésilien de ce fruit — je parle bien de cette « cerise » rouge que vous montrez en photo et que j’ai eu l’occasion de goûter sur place, comme on mange des mûres ou des groseilles sur le chemin des écoliers en France— est pitanga, issu d’ un mot tupi, pitang , signifiant « rouge ».
Je vais essayer d’en savoir plus.
Je viens de lire qu’en espagnol est aussi “pitanga” le nom du fruit et de l’arbuste ; pour l’arbuste il y a aussi “pitanguero”. Malheureusement notre dico ne dit rien de l’étymologie. Aussi, dans un lien de bonsaïs on l’appelle « manzana de agua » (pomme d’eau).
Qu’est-il donc arrivé, Pépé ? Mangé de “mauvaises” roussailles petit ? Pour ma part j’aime bien. Mais il est vrai que ma fille cadette, qui tend pourtant à être un vrai condé frugivore, ne se jette pas particulièrement goulûment sur les roussailles.
Leveto, si pitang signifie “rouge” en tupi, alors les roussailles d’un violet sombre ne devraient pas être appelées pitanga ! Mme Gurib-Fakim a certes un joli visage sur la 4e de couverture, mais elle dit parfois un peu n’importe quoi dans le livre dont on voit un extrait ci-dessus. (Et je ne parle pas là des fautes d’orthographe, qui sont légion.) Elle suggère que l’appellation pitanga est utilisée à Maurice — cf. la parenthèse (Mru.). Jamais je n’ai entendu qui que ce soit utiliser ce mot pour parler d’Eugenia uniflora, “roussaille” étant le seul que j’aie jamais ouï.
Jesús, je pense que les pommes d’eau que vous mentionnez ont davantage de chances d’être des jeanmalacs (ou “jamalacs”), alias Syzygium samarangense, qui contiennent beaucoup plus de liquide que les roussailles. Mais dites-moi une chose : comment appelle-t-on une groseille en espagnol ?
Dans ce lien (assez fiable à ma connaissance) est où j’ai trouvé la pomme d’eau.
De l’autre fruit le nom est « grosella », tiré du mot français.
Si grosella est tiré du français, on peut supposer que c’est la même chose pour le groselha portugais — lequel, selon Baker & Hookoomsing, pourrait avoir eu quelque influence dans la confection du mot roussaille, un mot en “néo-français”. Dans ce cas on pourrait sans doute parler de pollinisation croisée.
Pour ce qui est des pommes d’eau, en français il s’agit plutôt d’un arbre du genre Syzygium, l’appellation se partageant entre deux fruits assez semblables, le jambos (Syzygium malaccense, dont le pic de floraison cause une neige mauve sur le sol) et le jamalac (Syzygium samarangense, dont le pic de floraison cause une neige crème sur le sol). Il me semble que c’est à peu près la même chose en anglais pour ce qui est du fruit connu sous le nom de “water apple”. On ne saurait donner entièrement tort aux Français et aux Anglais pour cette fois, car ces fruits sont effectivement très juteux, ce qui compense un peu leur goût assez fade (surtout en ce qui concerne le jambos). Mais tout ceci est sans doute relatif, puisque les hispanophones, qui sont peut-être plus frugaux, peuvent semble-t-il se contenter de roussailles, a.k.a. “manzana de agua”, pour étancher leur soif.
_______
Ma femme passe par là et me demande ce que je fais. Je lui dis que je réponds à Jésus. Elle me fait alors remarquer que j’ai des amis haut placés. 😀
Ben, si je tape « manzana de agua » en Google.es je peux lire aussi quelques liens du « jambo » ou « jambu ». Un nom un peu plus graphique que j’ai vu est « pomarrosa » relié avec la forme (de pomme) et l’odeur (de rose).
Quant à Jésus, je comprends que votre femme soit étonnée. Il faut lui dire que, bien qu’avec des fautes, c’est Jesús qui ose écrire dans votre blog. Certes, si ma femme (qui est maintenant à 240 km) me demandait la même question et je lui répondais que mon com est pour Siganus, après avoir tapé ce nom, elle aurait trouvé un poisson ! 🙂
Dieu sait ce que ma femme aurait trouvé en googlant “Jesus”…
Cela n’arrête pas de m’étonner de voir à quel point ces fruits tropicaux de la famille des Myrtacées ont reçu une multitude de noms, dans une langue ou dans une autre mais aussi souvent au sein de la même langue, tant et si bien qu’à la fin on ne sait plus de quoi on parle — d’autant moins lorsque les fruits eux-mêmes se ressemblent.
Pas seulement pour les tropicaux. Au moins chez nous, les régionalismes et même les localismes changent les noms des plantes et des animaux (surtout des oiseaux et des poissons). Cette « Babel » me mets en rogne.
À la Réunion, on le connaît surtout sous l’appellation « cerise côtelée ». Ce fruit, qui était commun autrefois, se fait de plus en plus rare.
Jesús, disons que dans le cas des fruits tropicaux il s’agit souvent de fruits que les populations européennes connaissent relativement mal (sauf les bananes, les ananas, etc.), ce qui peut expliquer et excuser la confusion qui règne parfois dans la nomenclature. Mais sans doute retrouve-t-on ce genre de confusion à un niveau national, les appellations pouvant varier d’une région à une autre.
Je parlais plus haut de la prononciation “goussaille”. Au bureau l’autre jour un collègue disait avoir entendu cette façon de dire lorsqu’il était enfant dans la région de Port-Louis Nord. Mais il faut reconnaître que la prononciation des mots n’est pas toujours très rigoureuse à Maurice. Moi-même il m’arrive de dire “leksi” alors que la prononciation normale est “letsi” quand on parle du fruit de Litchi chinensis. Cela se retrouve même au niveau du nom des gens, comme par exemple dans le cas du ministre Anil Bachoo / Baichoo.
Carré de sucre, l’appellation la plus courante dans l’île-sœur serait “cerise côtelée” ? C’est noté, merci. Mais avez-vous déjà entendu parler de roussaille à la Réunion ? Le mot y a été utilisé semble-t-il (voir le billet), mais je me demandais s’il y est encore en usage, ne serait-ce que de façon restreinte. Il ne figure en tous cas pas dans l’inventaire des particularités lexicales du français de la Réunion (Michel Beniamino). Si, comme le suggère Alain Rey et Baker & Hookoomsing, le mot roussaille est issu du mot français groseille, on se serait attendu à ce que cette appellation soit en usage à la Réunion aussi.
Je reviens un peu tard sur le pitanga brésilien — après être remonté aux sources. Ce nom désigne bien le fruit de l’Eugenia uniflora (appelé là-bas pitangueira). Ces fruits sont essentiellement rouge vif comme nos cerises mais quelques variétés ont des tons plus foncés allant pour certaines jusqu’au presque noir, ce qui leur vaut le nom de Pitanga Preta, « pitanga noire ».
Aux Antilles — en tout cas en Guadeloupe — on parle plus de siriz kot (« cerise côtelée ») que de pitanga.. Je n’ai jamais entendu parler de « roussaille » là-bas, mais on ne parlait pas de ça tous les jours!
“Sur un mot donné des hommes tels que Bernard, Mallac, Arrighi, Chomel, Coudray, Thenaud, Maingard, Collin, Pitot — pour ne citer que ceux-là — improvisaient après boire des couplets fort joliment tournés. On ne peut s’empêcher, en relisant les meilleures de ces improvisations dans l’Anthologie Mauricienne de M. Edouard Fromet de Rosnay, d’évoquer les joyeux fantômes de ces charmants épicuriens de l’Ile de France réunis, le verre à la main, dans les bosquets de roussaillers* du jardin de Josse, à l’ombre des bois-noirs, des manguiers, des flamboyants et des badamiers, et d’admirer leur gaîté de bon aloi dont l’écho résonne encore jusqu’à nous, à travers les âges, avec une douceur réminiscente du bon vieux temps.”
Auguste Toussaint, Port-Louis, deux siècles d’Histoire (1936), page 272.
* l’italique est de l’auteur
Merci. Je cherchai des informations pour inclure dans une note biographique lorsque je suis tombe sur cet article fort intéressant qui me rappelle mon enfance non sans une angoisse nostalgique. Je me souvienne que je passai mon temps à la rivière ou au flanc des montagnes à grignoter les fruits faute de quoi à manger. Merci pour tout l’histoire. Cela m’a suscité tant d’intérêt que je songe sérieusement à rédiger un livret en anglais sur les fruits à Maurice et la politique pour les préserver.
Merci! Est-ce que la rousaille et l’acérola est le même fruit?
Pour compléter le dossier « roussaille », j’ai souvenir qu’à Maurice (début des années 70) on désignait une variété de piment sous le nom « piment roussaille », en raison de sa forme côtelée similaire à la roussaille. Ce piment très brûlant, peu apprécié à Maurice, avait sans doute été introduit récemment des Antilles, dont une forme voisine (« bondamanjak » en Martinique) portait à Maurice le surnom de piment « bodoudou » (par allusion à la chanson « ban mwen on tibo, doudou »). De façon générale, les piments des Antilles sont aussi détestés en Inde que goûtés en Afrique. Concernant le rapprochement de « roussaille » avec groseille, l’idée n’est pas à rejeter. Elle me rappelle que la roselle (Hibiscus sabdarifa), nommée brède « lozey » à Maurice, est appelée groseille à la Réunion et aux Antilles. Ce qui rapproche l’oseille, la roselle et la groseille (sorrel en anglais), outre la phonétique, est une saveur acidulée caractéristique.