Oursin cuirassé dépourvu de piquant :

Il existe donc des oursins qui ne piquent pas, mais une interrogation demeure : en français de France, parle-t-on plutôt d’épines d’oursin ou de piquants d’oursin ?


________
(Françoise a bien voulu donner le nom scientifique de cette espèce d’oursin : Colobocentrotus atratus.)
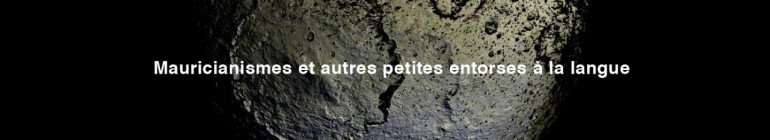

Personnellement, je parle de « piquants », je réserve les « épines » aux plantes ; wiki semble me donner raison : Les échinidés ou échinides (surnommés oursins, hérissons de mer ou châtaignes de mer) sont des organismes marins portant des piquants (non des épines) sur l’entièreté du corps. mais l’entièreté me laisse perplexe et je ne sais donc pas si l’information est fiable !
Merci de nous faire découvrir cette superbe espèce !
Pour les espèces communes en France, je parlais de piquants, mais maintenant … il devient évident que le terme ne convient pas dans tous les cas. Le terme scientifique radiole a un sens moins restrictif (voir lien ci-dessus).
Il y a également (rubrique anatomie externe) un schéma clair de l’organisation de l’oursin; les piquants sont absents de la zone autour de la bouche, sur la face inférieure.
Petit problème, le lien ne renvoie pas à la page de l’espèce : choisir la famille des Echinometridae, espèce Colobocentrotus atratus.
Françoise, merci pour Colobocentrotus atratus, aussi appelé “shingle urchin” en anglais — les shingles étant les bardeaux évoqués ici.
Sur cette page de l’Echinoblog, il est précisé que l’adhérence de ces oursins au substrat est beaucoup plus forte que chez d’autres espèces voisines. En effet, pour arriver à retourner l’un d’eux, comme on le voit sur la deuxième photo, il a fallu avoir de la poigne. (Je ne me suis cassé ni les ongles ni les dents, mais c’était border line*.)
Zerbinette & Françoise, c’est noté pour les piquants d’oursins. J’avais un doute car à Maurice tout est piquant :
épine de bougainvillée = piquant de bougainvillier ;
arête de poisson = piquant de poisson (encore qu’arête, à la différence d’épine, soit aussi employé en français local) ;
et donc : piquant d’oursin = piquant d’oursin.
* Je ne peux résister au plaisir de placer ce mauricianisme ici. La chair est faible, hélas…
J’imagine que, malgré l’absence de piquants, ces oursins auront aussi l’appareil dentaire qui a un nom tellement curieux : la lanterne d’Aristote.
Je suis d’accord avec Zerbinette et Françoise pour les piquants. Les épines, c’est pour les plantes, quoiqu’on puisse aussi parler de piquants pour certaines espèces, par exemple de cactus . Il me semble que je dirais plutôt « épine » si cet appendice se termine en une pointe de plus en plus fine, et « piquant » s’il garde le même diamètre sur toute sa longueur (comme une aiguille cassée). Le piquant peut donc nous piquer sans pénétrer dans la peau, au contraire de l’épine. Mais c’est peut-être seulement mon usage personnel.
Marie-Lucie, j’ai du mal à saisir la nuance entre piquant et épine selon que la chose perce la peau ou pas. Il me semble que le mot ne peut changer simplement parce qu’on a pu faire l’objet traverser l’épiderme, ce qui dépend de la pression appliquée. Il suffirait d’appuyer plus fort pour que le piquant fasse un trou. De même, l’épine ne pénètrera pas si la pression n’est pas suffisante.
Jesús : l’appareil dentaire qui a un nom tellement curieux : la lanterne d’Aristote.
Amusante, cette appellation. Il ne manque plus que Diogène dans le tableau.
Siganus, comme je l’ai dit plus haut, c’est peut-être seulement mon interprétation personnelle – je n’y avais jamais pensé auparavant et j’ai essayé de réfléchir à ce qui pouvait différencier ces mots dans mon expérience personnelle.
En fait je crois que pouvoir percer la peau n’est pas un critère, mais plutôt une conséquence: les épines peuvent être longues et fines, ou bien larges à la base (comme les épines de roses), mais elles finissent toujours en pointe plus fine que la base, tandis que les piquants me semblent être de la même grosseur sur toute leur longueur: ils piquent sans être acérés. C’est vrai pour les piquants des plantes, et preque autant pour les piquants de porc-épic, par exemple: ils sont très longs – certains ont bien 20 cm – creux et presque cylindriques, mais attaché au bout libre il y a un petit tortillon très fin qui s’enfonce dans la peau de qui s’y frotte – ou dans le museau d’un chien, par exemple – tandis qu’à l’autre bout le piquant se détache tout seul de la peau du porc-épic.
on a pu faire l’objet traverser l’épiderme
Est-ce que cette construction est un anglicisme (to make the thing go into the skin), ou une tournure maintenant utilisée couramment en français?
Pour Jesús « biblophile » :
Épine de Judas : vive (poisson épineux).
on a pu faire l’objet traverser l’épiderme
Marie-Lucie, Siganus parlerait-il comme monsieur Jourdain ?
Comme vous , curieuse d’en savoir plus sur cet l’appareil dentaire qui a un nom tellement curieux :
C.J. Kazilek éclaire nos lanternes : «À l’époque d’Aristote, les lanternes de cornes avaient 5 côtés, ce qui fait qu’elles servirent de comparaison pour décrire la forme de la bouche des oursins.»
Zerbinette: Siganus parlerait-il comme monsieur Jourdain ?
Peut-être, mais il y a longtemps que je n’ai pas rencontré le monsieur en question. Veuillez éclairer ma lanterne, ou bien raviver mes souvenirs, s’il vous plaît.
Je n’ai jamais entendu qui que ce soit utiliser cette structure à l’oral, et à l’écrit je ne l’ai lue que dans un ouvrage d’un historien qui, je crois, était de l’ouest de la France.
L’anglais présente de nombreuses survivances de l’anglo-normand (c’est-à-dire la variété de français passée en Angleterre après Guillaume le Conquérant), et il se peut que cette structure anglaise continue une structure normande, mais il se peut aussi que ce soit un anglicisme récent, soit simplement courant à Maurice, soit devenu courant en français contemporain comme tant d’autres.
les lanternes de cornes
????
>Marie-lucie
Selon j’ai lu, il semble que les lanternes étaient en corne, faites avec cinq plaques translucides mais je ne sais pas comment elles étaient aussi minces pour laisser traverser la lumière.
Ou, peut-être votre doute est pour le « de » ?
>Zerbinette
Merci.
Pour relier votre « biblophile »* et Judas, mon cas peut être exprimé avec notre proverbe « a la fuerza ahorcan » (+ ou – : de force ils [nous] pendent), c’est-à-dire, on fait ce que quelqu’un veut par force parce qu’il n’y a pas un autre choix.
J’aime aussi votre acception du mot « judas » comme petite ouverture dans les portes, pour nous « mirilla », un diminutif de « mira » (mire).
*Reconnaissant du compliment, mais pour éclaircir : « Biblophile » par bibliophile, mais vraiment, sans fausse modestie, un simple amateur ou, avec un sens péjoratif et même pédant, dilettante.
Jesús: ce n’était pas le « de » qui me dérangeait, mais le mot « cornes » au pluriel: il s’agissait bien de « lanternes de corne » ou « lanternes en corne » (le matériau, qui ne se met pas au pluriel).
Pour faire des objets en corne, on fait bouillir la corne, ce qui la ramollit assez pour qu’on puisse la dérouler et l’aplatir pour en faire divers objets (p. ex. des peignes). L’article de Wikipedia.fr sur « corne » (matière) donne quelques explications sur ce travail, mais il contient plusieurs termes techniques que je ne connais pas.
Selon le TLFI: « judas »: Petite ouverture, fermée d’une grille, d’un grillage, d’une trappe amovible pratiquée généralement dans une porte, parfois dans une cloison, plus rarement dans un plafond ou un plancher, et permettant de voir sans être vu.
Dans la littérature française on trouve souvent ce mot lorsque quelqu’un se présente à une porte de prison ou de couvent – il y a de l’autre côté de la porte une personne qui le regarde d’un oeil soupçonneux par un judas.
Je croyais trouver « judas » dans l’article Wikipédia.fr sur « porte » (il y a beaucoup de choses à dire sur les portes), mais contrairement à bien d’autres termes techniques que j’ignorais, il n’y était pas. Le mot moderne qui y correspondait le mieux était « un oeilleton », que je ne connaissais pas non plus mais qui désigne la petite lentille grossissante qui permet à l’occupant de voir la personne qui sonne à sa porte.
Marie-Lucie : Est-ce que cette construction [on a pu faire l’objet traverser l’épiderme]* est un anglicisme (to make the thing go into the skin), ou une tournure maintenant utilisée couramment en français?
Je ne saurais dire ce qu’il en est en France, mais je pense que cette tournure est relativement fréquente à Maurice. Normalement je fais attention à l’écrit — j’avais un professeur de français, mentionné dans la rubrique “about”, qui nous avait mis en garde contre ce péché-là —, mais il suffit d’être un peu fatigué, pressé, dérangé ou distrait pour que le naturel revienne au galop.
Mais parfois je suis pris d’un doute. Et c’est en cela qu’il est fructueux de se frotter, par commentaires interposés, à des Français “standard”. Sur le blog (Langue sauce piquante) qui a indirectement été à l’origine de ce blog-ci j’avais une fois parlé d’une tournure “mauricienne”, ou présumée telle, avant qu’un autre commentateur — peut-être Aquinze ou Zerbinette — dise que cela était d’un usage normal en français normal. Malheureusement je ne me souviens plus de ce dont il s’agissait.
La construction « faire quelqu’un faire quelque chose » n’est pas standard en français ? Par exemple « il a fait son chauffeur nous déposer à Port-Louis ».
*Accessoirement, comment aurait-il fallu dire pour être le plus académique possible ? J’ai comme si dirait un doute là. (“Comme si dirait”, voilà une autre expression permettant probablement de repérer son Mauricien à 30.48 mètres.)
La construction “faire quelqu’un faire quelque chose” n’est pas standard en français ?
Non. C’est une différence importante entre le français et l’anglais, et elle donne du fil à retordre aux apprenants des deux langues, car les structures sont ne sont pas comparables.
On dit « faire faire quelque chose (par quelqu’un) » ou « à quelqu’un ».
Dans le premier cas, l’important est la chose à faire, et on peut ne pas mentionner la personne qui exécutera l’ordre: par exemple « J’ai fait réparer ma voiture (par Untel) » (I have had my car fixed – by X).
Dans le second cas, l’important est de donner quelque chose à faire à une certaine personne: p.ex. « Mon fils voulait davantage d’argent de poche, alors je lui fais laver la voiture et tondre la pelouse ». ( I have him wash the car and mow the lawn).
Par exemple “il a fait son chauffeur nous déposer à Port-Louis”.
— Il nous a fait déposer à Port-Louis par son chauffeur. (He told his driver to take us to PL, he had his driver take us to PL).
Ces constructions ne sont pas « académiques », elles sont tout à fait naturelles (sauf si les anglicismes ont maintenant pris le dessus).
J’ai comme si dirait un doute là :
J’ai comme qui dirait un doute là-dessus.
m-l: The M. Jourdain in question is presumably the one from Moliere, who is astonished to learn at age 60 or so that he has been speaking in prose all his life.
Of course, it’s not really true: the rhythm of spoken language is normally neither prose nor verse, but a tertium quid that Northrop Frye, the great Canadian literary critic, called « associative babble ». People who actually do speak in prose are the over-educated, who are said — at least in English — to talk like a book, an accusation often applied to me with much justice.
JC, I know very well who Monsieur Jourdain is, but I don’t remember what he said that made Zerbinette think that Siganus spoke like him, and I don’t have a copy of Le Bourgeois Gentilhomme with me.
The only thing I can think of is that at one point M. Jourdain has written a short note he wants to send to his lady love, but he thinks it is too plain and he wants his tutor to rewrite it, but he insists that the rewrite should use the same words as his original version. The tutor suggests several different word orders, getting more unnatural and ridiculous with each attempt, so that in the end the original sentence turns out to be the best one.
I agree with you about the verse/prose/casual-oral distinction. My writing is extremely different from my speech. En français aussi on dit « parler comme un livre », but I think that it is (or used to be?) rather a positive comment (I take it to refer to the content rather than the form).
Marie-Lucie, des propos entendus aujourd’hui qui pourraient illustrer ce dont nous parlions plus haut : “Ce sont des grains juste pour mouiller tout, et faire la vapeur monter après.” Ce faire la vapeur monter après — sous-entendu : après la pluie, car il a fait assez chaud aujourd’hui, avec des averses intermittentes, ce qui faisait monter le taux d’humidité — m’a fait songer à ce prof de français qui dénonçait nos tournures de phrases, et je me suis fait la réflexion que celle-là l’aurait probablement fait sourciller. Qu’en pensez-vous ?
À mon avis, ces tours de phrases où le nom est placé entre « faire » et un second verbe sont des anglicismes, ce qui n’est pas étonnant dans un pays bilingue ou multilingue, mais il n’est pas exclus qu’elles soient d’un emploi courant dans certaines variétés de français, c’est pourquoi je pose ces questions.
Petite leçon de grammaire:
En français standard, le verbe qui porte le sens (ici monter) se place toujours immédiatement après « faire » (qui fonctionne presque comme un auxiliaire), on dirait donc …. pour faire monter la vapeur…, comme dans votre phrase ici ce qui faisait monter le taux d’humidité.
La différence entre cette construction-ci et celle des exemples précédents est que dans celle-ci le second verbe est intransitif (n’a pas de complément d’objet direct), dans les autres exemples il est transitif:
A. ex. La pluie fait monter la vapeur.
= à cause de la pluie, la vapeur monte.
(dans cette construction, l’ordre du sujet et du verbe ici intransitif monter sont inversés – mais le résultat est que le nom se comporte comme l’objet du groupe verbal fait monter).
B. ex. Je fais réparer ma voiture (par X)
= Sur mes ordres, quelqu’un (= X) répare ma voiture.
ex. Il nous a fait déposer à Port-Louis par son chauffeur.
= Sur ses ordres, son chauffeur nous a déposés à Port-Louis.
ex. Je fais laver ma voiture à mon fils>.
Je lui fais laver ma voiture.
= Sur mes ordres, mon fils (= il) lave ma voiture.
ex. Je fais faire leurs devoirs à mes enfants.
= Sur mes ordres, ou sous ma surveillance, mes enfants font leurs devoirs.
ex. Je leur fais faire leurs devoirs.
= Sur mes ordres, ou sous ma surveillance, ils font leurs devoirs.
ex. Je la fais laver à mon fils.
= Sur mes ordres, ou sous ma surveillance, mon fils la lave.
(avec un verbe transitif, le verbe et son objet direct restent toujours dans leur ordre normal; si l’objet est un pronom, il est avant le groupe verbal « faire » + verbe).
>Marie-lucie
Pour « la pluie fait monter la vapeur », l’expression « la pluie la fait monter », est-elle incorrecte ?
Jesús, je pense que « la pluie la fait monter » est tout à fait correct. Ou « la pluie l’a fait(e) monter » — j’ai comme qui dirait un doute sur l’accord du participe ici. Pour reprendre ce que disait Marie-Lucie ci-dessus, il y aurait une sorte d’auxiliaire double dans ce cas-ci. MM. Hanse et Blampain, pour leur part, disent ceci : 4. Faire suivi d’un infinitif. (…) On ne dit pas [une maison faite construite par mon père], mais : qu’a fait construire mon père.
Jesús: l’expression « la pluie la fait monter », est-elle incorrecte ?
Elle est tout à fait correcte, mais je n’ai pas essayé de citer tous les exemples possibles.
Siganus, « la pluie l’a faite monter » (= « la pluie a fait monter la vapeur ») se dit fréquemment aussi, mais ce n’est pas considéré comme correct (= standard) parce que « la vapeur » ne fonctionne pas comme l’objet de « faire », ni celui de « monter », mais celui du groupe « faire monter » qui ne s’emploie pas exactement comme un verbe simple.
Quant à l’autre exemple que vous citez: On ne dit pas [une maison faite construite par mon père], mais : qu’a fait construire mon père., je suis d’accord avec ces messieurs.
En français standard le groupe « faire + infinitif » ne peut pas se mettre à la voix passive (ce qui est sous-entendu dans la phrase: la maison [qui a été] faite construite …), quel que soit le type (transitif ou intransitif) du verbe à l’infinitif. Mais dans la conversation on dirait plutôt *la maison que mon père a fait construire*, car l’inversion avec sujet après le verbe est plutôt littéraire.
Si une maison faite construite … est courant à Maurice (puisque ces messieurs connaissent cette construction), il s’agit d’un mauricianisme, syntaxique celui-ci.
Si une maison faite construite … est courant à Maurice (puisque ces messieurs connaissent cette construction), il s’agit d’un mauricianisme, syntaxique celui-ci.
Non, ces messieurs sont belges, et je n’ai jamais entendu une telle construction à Maurice (où, by the way, on a un peu tout et n’importe quoi en matière de construction et d’“urbanisme”). Ici on dirait plutôt “la maison que mon père a fait construire”, voire “la maison que mon papa a fait ranger”, père n’étant guère utilisé, si ce n’est sous la forme “un mon-père” pour parler d’un curé.
La construction “faire + substantif + verbe à l’infinitif” est très fréquente à Maurice, en français “local” et en créole (il s’agit même de la forme standard pour ce dernier). Je ne sais pas si cela est dû à une influence de l’anglais (je tends à penser que oui), mais je trouve difficile de s’en affranchir, les formes correctes me semblant souvent empruntées et peu naturelles. Une question d’habitude sans nul doute.
Linn faire so zenfan boire so dilait = elle a fait son enfant boire son lait = elle a fait boire son lait à son enfant ► Si je dis la dernière phrase au cours d’une conversation courante à Maurice, je risque de passer pour un précieux (bien que cela dépende des interlocuteurs présents).
Si la construction … faite construite … est belge, Aquinze pourrait peut-être nous le confirmer.
Je comprends que les constructions françaises peuvent sembler peu naturelles à des gens qui sont habitués à celles qui imitent l’anglais et qui sont maintenant peut-être typiques du français mauricien, mais elles n’en sont pas moins naturelles pour le français « hexagonal » (à moins que celui-ci lui aussi ait adopté ces anglicismes – il en a bien adopté d’autres, d’après ce que je peux lire). Mais comme je l’ai dit plus haut, il se peut aussi que ces tournures anglaises soient déjà courantes depuis longtemps dans certaines variétés françaises qui ne me sont pas familières.
Aquinze semble avoir disparu corps et biens. (La Belgique est un pays troublé par les temps qui courent.)
Il faut faire Interpol lancer les recherches.>Marie-lucie, Siganus K.
Mon doute était basée, selon j’avais compris, sur votre affirmation : « verbe ici intransitif monter » ; dans ce cas il n’y a pas d’objet direct mais j’ai vu « la vapeur » comme possible.
Pour l’accord du participe passé, dans « La grammaire, c’est pas de la tarte !», l’ami Houdart a écrit un chapitre qui éclaircit ces doutes. Malheureusement, de moi et le livre c’est ce dernier le seul qui est chez moi maintenant.
Jesús: « verbe ici intransitif monter » ; dans ce cas il n’y a pas d’objet direct mais j’ai vu « la vapeur » comme possible.
« La vapeur monte« : le verbe « monter » est intransitif.
« La pluie fait monter la vapeur »: « la vapeur » se comporte en objet du groupe verbal « fais monter », pas de « faire » ni de « monter » individuellement.
Est-ce que l’espagnol n’a pas la même construction? (hacer + infinitivo)
Pour l’accord du participe passé, comme beaucoup de gens trouvent les règles classiques difficiles (c’est vrai qu’elles le sont dans bien des cas), le ministère de l’éducation en France a décidé de recommander une plus grande tolérance qu’autrefois. Je ne sais pas ce que dit M. Houdart, dont je ne connais pas les oeuvres, mais il n’est sûrement pas le seul à s’être prononcé sur le sujet.
En espagnol, il y a longtemps que le problème a été résolu, s’il a jamais existé!
p.s. J’ai écrit « le verbe ici intransitif » parce que « monter » peut aussi être transitif (p.ex. « monter l’escalier »), mais il est intransitif dans « la vapeur monte ».
Tiens, Marie-Lucie, vous me faites penser qu’à Maurice on “monte une montagne” de la même manière qu’on monte un escalier, alors qu’on devrait en principe dire “on a gravi le Pouce” ou “on est monté sur le Lion”.
Pour moi, « gravir » est un terme plutôt littéraire – je ne le dirais pas dans la conversation.
On monte « un escalier » mais « sur une montagne » (si on va jusqu’au sommet), aussi bien que « sur une échelle » (si on reste dessus quelque temps): l’escalier est un moyen, pas un but comme le sommet d’une montagne, et l’échelle ne fonctionne pas exactement comme un escalier puisque souvent on s’y perche un certain temps pour s’y livrer à une activité dans les hauteurs (cueillir des fruits, peindre un mur, etc), ce qu’on fait rarement sur un escalier. Mais pour grimper sur un toit, par exemple, on « monte à une échelle » (puisqu’on n’y reste pas).
p.s. J’aurais dû dire: « ce qu’on fait rarement dans un escalier ». On peut s’asseoir sur une marche, mais dans l’escalier.
>Marie-lucie
Merci de vos explications.
Et oui, nous avons aussi « hacer+infinitivo ».
Quant aux livres, voyons ! Il s’agissait d’un clin-d’œil à Siganus pour l’ami de LSP.
Je n’ai pas étudié que l’accord ait été un problème en espagnol. Je crois que nos deux couples de verbes « ser y estar » (être) et « haber y tener » (avoir) ont quelque chose à voir avec la question.
l’escalier est un moyen, pas un but comme le sommet d’une montagne, et l’échelle ne fonctionne pas exactement comme un escalier puisque souvent on s’y perche un certain temps pour s’y livrer à une activité dans les hauteurs
Quid de l’arbre dans lequel on monte (ou dans lequel on grimpe) ? Je connais quelqu’un qui, ayant grandi en milieu anglophone, tend souvent à dire, en parlant d’un chat par exemple, « il a monté l’arbre » ou « il a grimpé le mur ». Ça me fait tiquer à chaque fois, mais rétrospectivement, du point de vue du sens, je ne vois pas bien ce qui empêcherait de le dire. D’autant moins que “monter une montagne” ne me choque pas du tout tant je l’ai entendu dès mon plus jeune âge, ce qui n’est le cas ni pour “monter l’arbre” ni pour “grimper le mur”. Tout cela semble avant tout être une question de convenances et d’habitudes.
Mais pour grimper sur un toit, par exemple, on “monte à une échelle” (puisqu’on n’y reste pas).
Tiens, voilà un tour que je n’utiliserais pas personnellement. A mon enfant qui veut aller sur la dalle j’aurais dit « fais attention en montant sur l’échelle », même si le but final est le toit qui se trouve en haut de ladite échelle, un peu de la même façon qu’on dit « traverser sur une passerelle » ou « monter sur le trottoir ». Mais je dirais peut-être « grimper à la corde » (une formule quasi-figée), ou « grimper le long de la corde » (ou « descendre le long de la corde », ce qui est nettement plus facile).
Justement, en espagnol on n’accorde pas le participe passé avec le pronom objet direct placé avant l’auxiliaire « haber », comme on le fait en français si l’auxiliaire est « avoir »: essayez donc de traduire les phrases suivantes et voyez si en espagnol le participe passé change dans les deux versions d’une même phrase:
ex. Elle avait compris la question : Elle l’avait comprise.
ex. Il avait pris les clés : Il les avait prises.
ex. Il avait construit la maison : Il l’ avait construite.
ex. Il avait acheté la maison : Il l’ avait achetée.
ex. Il avait fini la lettre : Il l’ avait finie.
ex. Elle avait reçu les lettres : Elle les avait reçues.
Dans les deux premiers cas, le participe passé a une consonne que l’on entend qu’au féminin. L’accord ne présente donc pas de problème, sauf s’il y a aussi une question de singulier ou de pluriel.
Dans les autres cas, le participe passé se termine par une voyelle pour les deux genres, et on ne peut donc pas se fier à la prononciation pour savoir comment écrire la fin du participe. Il faut donc apprendre la règle pour savoir comment l’écrire.
Avec mes élèves j’expliquais cette règle ainsi: si l’objet est un nom, il vient après le verbe, et si on s’arrête de parler avant de dire l’objet on ne peut pas savoir ce qu’il va être, donc pas d’accord possible (ex. Il a acheté …). Mais si l’objet est un pronom, qui vient avant le verbe, on sait en général quel nom ce pronom remplace, et on sait donc avec quoi il faut accorder le participe passé qui va suivre (ex. Il l’a achetée – dans un texte normal, on sait déjà que c’est une maison, etc, d’après une mention précédente). Même chose pour:
ex. C’est la maison qu’il a achetée. (où le pronom objet est « que », qui se rapporte à « la maison »).
Ce n’est pas très classique comme explication, mais ça marche au point de vue pratique.
Comme (selon ce que j’ai appris en lisant) l’espagnol ne fait pas l’accord dans ces cas-là, il n’y a pas à se demander s’il faut le faire, ni comment écrire les participes en question.
Marie-Lucie, parfois les choses sont plutôt tordues en ce qui concerne ce fichu participe passé. Les verbes pronominaux par exemple continuent d’être pour moi un piège récurrent. Mais ce ne sont pas les seuls dans ce cas. Il y a de cela quelques années, une vieille dame aujourd’hui partie au paradis des grammairiens, m’avait posé une question que j’avais soumise à la sagacité collective des commentateurs du blog des correcteurs du Monde.fr (belle brochette de prépositions) :
Un certain nombre de participants avaient pris à cœur d’examiner la question, dont Aquinze — qui était encore A1528 — et Leveto.
Siganus, je répondais à Jesus, pour montrer la différence que qui existe entre le français et l’espagnol, où on ne fait pas l’accord dans le contexte de l’auxiliaire ‘avoir ». Et quand j’ai décrit mon explication pour me élèves (de français langue seconde), il s’agissait des cas les plus courants, et je crois avoir noté qu’il y avait des cas beaucoup plus complexes où on pouvait hésiter.
Il est trop tard ici pour que j’essaie de me pencher sur le case de la dame aux 75 printemps, mais je continuerai peut-être demain.
Sig, mieux vaut tard que jamais (pour que je me penche sur votre problème !)
Il y a des cas où je n’emploie pas « que » mais « où » :
les heures où j’ai dormi,
les années où le roi a régné,
les années où il a vécu dans la misère,
l’on retrouve ici le complément circonstanciel évoqué par leveto et cela résout immédiatement le problème d’accord.
Vivre peut être soit intransitif, soit transitif (et de même pour coûter).
Pour les « printemps », j’utiliserai sans hésitation la forme transitive et le « que » avec l’accord du participe passé ! Car si l’on emploie le mot « printemps », pour moi cela implique que non seulement cette vieille dame les a vécus pleinement, mais qu’elle les a savourés !
Zerbinette, je suis absolument d’accord avec vous pour les « printemps », à la fois pour la grammaire et pour l’interprétation. Même s’il y avait « des années », ou même « des mois » ou des périodes plus courtes, mon interprétation serait la même (même si « savourer » n’est pas toujours le bon mot si ce sont des années tragiques ou à problèmes que l’on a vécues).
Je crois que le verbe « vivre » n’appartient pas au même groupe sémantique que ceux qui s’emploient avec des mesures (coûter, peser, mesurer, etc) et pour lesquels on fait ou non l’accord du participe passé selon que l’on considère la mesure comme une totalité ou comme un ensemble d’unités sur lesquelles on fait des opérations. Il appartiendrait plutôt à un groupe où figurerait le verbe « passer », donc : « les années que nous avons passées ensemble » = « les années que nous avons vécues ensemble » (sous-entendu : ensemble, nous avons passé = vécu ces années)
Si on voulait parler de la période qui comprend les années en question (plutôt que de tout ce qui a pu se passer pendante ces années), il faudrait mettre « les années où = pendant lesquelles nous avons vécu ensemble » (sous-entendu: pendant ces années, nous avons vécu ensemble).
Ce que disent les Belges :
Vivre est intransitif (et son participe invariable) quand il signifie simplement « être en vie » :
Les nombreuses années qu’il a vécu (pendant lesquelles il a vécu) lui ont donné une riche expérience.
Mais il devient transitif, et le participe passé est alors variable, dans trois cas où le sens est :
– « Passer, mener, traverser » ; on pense alors à la qualité de la vie, à son aspect particulier et l’accord peut parfois suffire à suggérer cette idée :
La vie heureuse qu’il a vécue. Les dix années de misère qu’il a vécues… L’existence qu’il a vécue pendant quatre ans l’a rendu indulgent. On ne pourrait dire : pendant laquelle, pendant lesquelles.
On constate que certains écrivains laissent alors le participe invariable :
Quelles heure il avait vécu ! (François Mauriac, Les chemins de la mer.) Me voici arrivé aux pages les plus sombres de mon histoire, aux jours de misère et de honte que Danielle Eyssette a vécu à côté de cette femme (Alphonse Daudet, Le petit Chose.) Quelles étranges minutes elle avait vécu ! (Julien Green, Léviathan.)
L’accord est préférable.
– « Traduire en actes dans sa vie » : Sa foi, il l’a courageusement vécue.
– « Éprouver intimement, par l’expérience personnelle faite au cours de la vie », « sentir profondément » :
Les génies disparus, dont l’âme revit dans ces musiques qu’avait vécues leur vie (Romain Rolland, Jean-Christophe, Le matin). Ses propres expériences, celles qu’il avait vécues (L. Faure, Mardi à l’aube).
(Joseph Hanse, Daniel Blampain, Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne, 4e édition, page 418.)
Pour ma part je suis incliné à écrire « les soixante-quinze printemps que tu as vécu ».
Sig, mon « dictionnaire orthographique et grammatical » qui n’est pas belge est cependant d’accord avec le sens transitif qui a une nuance qualitative ; et c’est bien pour cela que j’écris « les 75 printemps qu’elle a vécus » !
Cela prouve simplement que nous n’avons pas la même appréciation du printemps en Berry qu’ à Maurice…..
Et j’incline à penser qu’il vaut mieux éviter le « que » dans le sens intransitif.
>Marie-lucie, Zerbinette
Sans rien à voir, votre : « ceux qui s’emploient avec des mesures (coûter, peser, mesurer, etc.) » m’a souvenu le célèbre : « Mane, thecel, phares ».
C’est vraiment Jesús biblophile ! (et bibliophile !) 😉
Le « célèbre » : « Mane, thecel, phares » m’a laissée perplexe jusqu’à ce que je consulte google et Daniel !
>Zerbinette
Je n’oublierai jamais l’image d’un album que j’avais à mes 9 ou 10 ans où ce dessin était. Pour moi cette histoire est incroyable, mais jolie et émouvante. Après, il y a peu d’années, j’ai trouvé un article scientifique/divulgateur sur mesures avec ce titre.
Un tableau sur ce sujet :
Pardon!
Je ne sais pas pourquoi le lien du tableau de Rembrant a été ajouté comme ça.
Zerbinette: Et j’incline à penser qu’il vaut mieux éviter le “que” dans le sens intransitif.
Encore une fois, je suis tout à fait d’accord.
Le mot « que » tout seul prête à confusion entre le pronom relatif objet (dont l’antécédent conditionne l’accord du participe passé du verbe *vivre* considéré comme transitif) et la conjonction passe-partout qui ici semble insuffisante quand elle veut dire « pendant (l… quel…), conjonction qui serait suivie de *vivre* intransitif. Il y a donc double ambiguité, sur *que* et sur *vivre*.
« Mane, thecel, phares »
Est-ce qu’on n’écrit plus les accents qui permettent de prononcer cette phrase à peu près correctement? Je me souviens d’avoir appris « Mané, thécel, pharès ».
Il y a une autre tournure pour laquelle j’ai des doutes, une tournure dans laquelle le verbe se retrouve à la fin de la phrase. J’en ai eu un exemple sous les yeux en voyant la couverture de L’Express Dimanche, sur laquelle figurait le titre suivant : “Ce que l’électeur attend”. En français plus standard ne dirait-on pas plutôt “Ce qu’attend l’électeur” ? Il me semble qu’on rencontre souvent ce type de construction à Maurice. Plus qu’en France ?
I’m absolutely stunned that Google Translate knows that the English for Mane, thecel, phares is Mene, Tekel, Upharsin, which is closer to the original Aramaic. These were names of weights and monetary amounts, which were once the same, as pound still is in Britain, though you can no longer get a pound (454 g) of silver for £1 — more like 4g today. Tekel in particular is a variant of Hebrew shekel, which is now once again the currency of Israel. In the Smith-Goodspeed American Translation of 1923-39, the phrase is punningly rendered in accordance with the monetary interpretation as « You will be quartered, halved, and cent [sic for sent] to perdition. »
We still speak in English of seeing the writing on the wall, meaning foreseeing doom or ruin.
Jesús, moi aussi lorsque j’avais 8 ou 9 ans, on m’a raconté l’histoire, mais j’avoue que j’en étais restée simplement à une inscription sur le mur et d’ailleurs même avec le tableau, je n’aurais pas été beaucoup plus avancée pour la lire…. 😉
Le tableau qui a le plus marqué ma petite enfance est le Saint Sébastien de Mantegna, sans doute à cause de son air paisible malgré les flèches, il avait l’air d’aimer ça ! Il faisait partie des « planches » en noir et blanc encartées dans le petit Larousse de l’époque.
Marie-Lucie, sauf s’ils sont totalement intégrés au français, on évite de mettre les accents sur les mots étrangers. Mais il parait que le nouveau Larousse admet même à priori !
“Ce que l’électeur attend”. En français plus standard ne dirait-on pas plutôt “Ce qu’attend l’électeur” ?
Alors ça, je crois bien que ça ressemble à une colle. J’ai cherché les occurences sur google et il semble que la deuxième formule revienne plus souvent. J’aurais tendance à penser que le mot venant juste après la conjonction est celui sur lequel on veut insister (ici l’électeur).
L’électeur et ce qu’il attend:
En anglais, on ne fait jamais l’inversion du sujet et du verbe dans le cas d’une proposition relative (et on la fait rarement de toute façon). Les traducteurs ont donc tendance à ne pas faire l’inversion lorsqu’ils traduisent un texte anglais. Quand on voit de plus en plus de textes traduits qui suivent la syntaxe anglaise, on s’y habitue et on commence à oublier la syntaxe française, qui à l’écrit utilise en général l’inversion. (C’est l’un des nombreux cas où l’exemple de l’anglais fait oublier le français).
Le « que » ici n’est pas une conjonction mais le pronom relatif objet direct: l’électeur attend quelque chose – cette chose, c’est ce que l’électeur attend = … ce qu’attend l’électeur.
En général, lorsqu’on veut insister sur mot, on le met soit au début de la phrase (en français entouré par « c’est … qui, que, etc »), soit à la fin. Si on veut insister sur « l’électeur », il faudrait donc mettre « ce qu’attend l’électeur ».
Marie-Lucie : honte sur moi et sur la conjonction !
Sinon, je ne fais pas vraiment de différence entre les deux phrases.
C’est vrai qu’il n’y a pas vraiment de différence entre ces deux phrases, sauf du point de vue stylistique: avec l’inversion, il s’agit d’un niveau de langue plus « soutenu » que sans l’inversion. Le français oral courant, et particulièrement celui des enfants, ne font pas l’inversion. Pour le français écrit, le manque d’inversion me paraît en partie lié à l’influence de l’anglais.
Il ne s’agit pas ici d’une traduction. L’Express est directement écrit en français (du moins je le pense). Mais il est courant ici-bas de tomber sur ce type de construction, et il est tout à fait possible que nous ayons là une influence inconsciente de l’anglais.
« Ce qu’attend l’électeur » me paraît plus français que « ce que l’électeur attend », mais je ne vois pas vraiment ce qui, rationnellement, justifie l’inversion du sujet et du verbe. D’ailleurs, quand on remplace le substantif par un pronom personnel il devient impossible de les inverser : « ce qu’il attend », et non « ce qu’attend-il ».
Siganus, vous avez parfaitement raison de dire que l’inversion ne s’applique pas si le sujet est un pronom. Mais dans la structure d’une langue tout n’est pas forcément « rationnel » – sans quoi toutes les langues auraient la même structure, ce qui n’est pas vrai (n’en déplaise à Chomsky).
Il y a quand même une certaine logique dans l’inversion du sujet d’une proposition relative: elle est particulièrement utile si le sujet est beaucoup plus long que le verbe. Par exemple, dans « c’est ce qu’attend l’électeur qui, à cause de telle ou telle chose, souhaite tel ou tel changement politique etc », le sujet « l’électeur » est près du verbe, et il est suivi de ses propres compléments; mais si on commençait par « c’est ce que l’électeur qui, ……….., attend », le sujet serait séparé de son verbe par toute une série de mots, et on pourrait oublier à quoi se rapporte le verbe lorsqu’il apparaît de façon presque incongrue tout à la fin de la phrase, surtout si ce verbe a un sens vague ou très général, comme « est » ou « fait » (mais cela se fait en anglais).