Si la première phrase était en français : « Par mesure de précaution contre le virus H1N1. »
Si elle était en créole : « Par prekosyon kont viris H1N1. »
Si la deuxième phrase était en créole : « Lav zot lame avan manze, ek plizyer foi par zour. »
Si elle était en français : « Lavez-vous les mains avant de manger, et plusieurs fois par jour. »
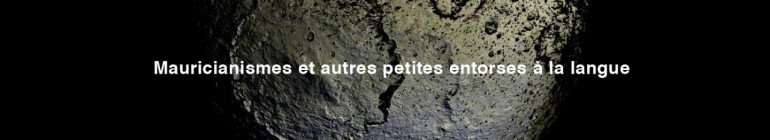

C’est le problème du multilinguisme: la phrase française est traduite de l’anglais, la phrase créole du français, et chacune garde des traces de la langue dont elle est traduite.
On dirait que c’est « la grippe cochonne » que dit le créole, mais c’est peut-être seulement « la grippe des cochons »?
Je ne pense pas que la première phrase soit traduite de l’anglais. Je pense plutôt que ceux qui ont rédigé cet avis n’arrivaient pas trop à se décider en quelle langue ils allaient le faire : français ou créole. Il me semble qu’ils ont commencé en français mais qu’en cours de route ils se sont dit qu’il fallait passer au créole (puisqu’on s’adressait à des ouvriers), d’où l’omission de l’article défini tel que le pratique le créole.
Ensuite la deuxième phrase se veut être en créole, mais c’est d’un créole partiellement francisé qu’il s’agit.
Bref tout ce mélange indéfini est bien mauricien…
> Marie-Lucie
Oui, « lagrip koson » (dont la fin se prononce comme « garçon”) est en somme la « grippe des cochons », ou la « grippe qui vient des cochons », tout comme la grippe aviaire est devenue « lagrip kanar ».
Pour la linguiste : comme souvent en créole, l’article a été agglutiné au nom. Grippe = lagrip. « Une mauvaise grippe » se dira « enn mové* lagrip », « cette grippe-là », « sa lagrip-la ».
* Je me répète sans doute en disant qu’en créole, selon « Grafi Larmoni », il ne devrait pas y avoir d’accents. Mais il me semble que c’est là se priver d’un moyen facile de s’affranchir de certaines ambiguïtés et de donner une indication on ne peut plus claire quant à la prononciation. Après tout Grafi Larmoni, qui est une tentative d’harmoniser l’écriture du créole, n’est qu’un ensemble de propositions. Il aurait été facile, dans l’exemple ci-dessus, de lire « mauve » (violet) ce qui en l’occurrence aurait normalement dû s’écrire « move ». J’ai l’impression que la « mise au rebut » des accents est avant tout due à une considération pratique : l’omniprésence des claviers QWERTY, sur lesquels obtenir un -é est un peu une gymnastique. Et puis peut-être, aussi, une dernière trace d’idéologie, celle-là même qui trouvait que l’écriture du créole devait être la plus éloignée possible de celle du français.