(…)
ki koson ? – koson dan park
ki park ? – park diboi
(…)
IL EST INTERDIT DENTRER DANS LE PARC
Ш
TLF :
Parc
A. −1. Parc (à moutons). Clôture légère et transportable servant à enfermer les ovins la nuit en été dans les prés; par métononymie, espace ainsi délimité. Synonyme – parcage.
2. Prairie d’élevage notamment bovin, limitée par une clôture fixe. Synonyme – pacage.
− Parc (domestique). Lieu où sont logés les bestiaux et/ou enclos attenant.
(…)
4. Parc (à bébé). Petit enclos léger, de forme diverse, facilement transportable, permettant à un enfant en bas âge de jouer en sécurité et d’apprendre à marcher. Mettre, faire jouer un bébé dans son parc.
Ш
Ki passé la ? – marsan dilé
Les paroles ici.
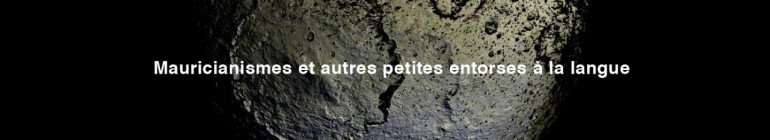

Siganus K vous etes un génie..Trop TOP la photo & la légende
KI parc, parc coson , qui coson ; coson dans bois; ki di bois di bois colofane, & mo donne li 4 coups batons…. ..
Qui se souvient de POONAC ???
Quand on était un peu faiblare…. on disant « eh ta alle manze poonac. » » ».de nos jours c est » Alle boire éne Red bull « »
Qui sait a base de quoi est fait le poonac????
In English pen is similarly used in all these cases, although I’m not sure that everyone feels the derivation of playpen from pen.
>Lorraine largesse
Voilà ce que j’ai trouvé:
http://www.thefreedictionary.com/Poonac
Merci a Jesus…pour le poonac..J ai aussi trouvé une bonne et complète explication dans le livre de Rouillard & Guého sur le poonac…
Qui veut des infos…????
Génial ki passé la ???marsan dilai….C était « une comptine » » qu on chantait enfant…
IL y avait aussi…
Terre de pipe..pipe en bois, bois campéche péche, a la ligne , ligne de fond , fond de culotte , culotte de zouave , zouave d afrique , fricassé ,serkoyan, yatangan, gant de peau, peau de lapin , lapin de garenne ,reine d angleterre !!! terre de pipe…. mais cela semble loin de notre folklore si joliment chanté dans le clip….L LAGESSE
.
Jesús, votre lien dit ceci :
Je me demande si Webster n’a pas fait une erreur typographique ici. Si j’ai bonne mémoire le poonac est une nourriture pour animaux provenant du résidu des noix de coco utilisées pour faire de l’huile. Dans ce sens, j’aurais mieux vu “prepared from the coconut” plutôt que “prepared from the cocoanut” (il me semble, toutefois, que le cacao produit bien des noix). Mais peut-être le poonac américain est-il différent…
Lorraine, que disent ces messieurs sur le poonac mauricien ?
John, indeed pen seems to be the English equivalent to parc. In my copy of the Harrap’s, pen is given as:
(a) parc, enclos (à moutons, etc.) ; Nau cage; bull pen, toril; pig pen, US hog pen, porcherie; play pen, parc;
(b) Nau abri (de sous-marins);
(c) Am Sl (penitentiary) tôle, taule, trou.
Acceptation (a) fits pretty well, (b) and (c) being called by other names in French.
Etymonline.com gives the word pen as (possibly) cognate with pin: “perhaps related to Old English pinn ‘pin, peg’ (see pin) on notion of a bolted gate or else ‘structure made of pointed stakes.’” That could therefore be related to the French word pêne (the mobile piece of a lock, i.e. a latch, a bolt). In its etymological part, TLF says this: “mentionné par les dictionnaires de Trévoux, s.v. pesne, pêne, du latin pessulus «id.», probablement du grec πάσσαλος «clou, cheville, piquet».”
Sinon, personne n’a pitié de cette tortue et de ses consœurs, elles qui aiment en principe gratter la terre et qu’on a mis ici à vivre sur une surface entièrement bétonnée ?
Lorraine, une variante (parmi d’autres) :
J’en ai marre, marabout, bout de ficelle, selle de ch’val, ch’val de course, course à pied, pied-à-terre, terre de feu, feu-follet, lait de vache, vache de ferme, ferme ta gueule, gueule de bois, bois de campêche, pêche à ligne, ligne de fond, fond d’culotte, culotte de zouave, zouave d’Afrique, fricassée, C’EST ASSEZ ! (ou bien : cétacé dit la baleine)
Siganus, le ciment ne descend pas vers un petit bassin où la malheureuse tortue pourrait se baigner, sur la droite ?
Zerbinette, tout est bétonné, le bassin comme le reste. (Nota : le ciment est une poudre que l’on mélange avec de l’eau et des agrégats pour faire du béton. Ce n’est qu’un ingrédient du béton (ou du mortier), pas le résultat final durci.) On remarque aussi les traces résultant du frottement des carapaces sur les poteaux en béton. Avoir fait des colonnes rondes aurait probablement été plus confortable pour les tortues.
Sur la page du Trésor de la Langue Française (TLF) que j’ai mise en lien dans le billet (voir ci-dessus) on trouve aussi ceci :
B. −1. Parc(-)aux(-)Cerfs
a) HIST. Maison d’un quartier de Versailles bâtie sur l’emplacement d’une réserve de gibier dépendant du château, où des rencontres galantes auraient été ménagées à Louis XV.
b) Par analogie – Lieu réservé à des rendez-vous galants.
Or il existe un lieu-dit à l’est de la Mare aux Vacoas qui porte ce nom-là (voir l’extrait de carte (cliquable) en partie basse de cette note : https://mauricianismes.wordpress.com/2009/09/30/mare-aux-vacoas/). On peut se demander si ceux qui l’ont nommé “Parc aux Cerfs” l’ont fait en ayant en tête ce qui figurait dans certains dictionnaires…
Par ailleurs, à Maurice le plus souvent on parque les voitures lorsqu’il s’agit de ce qu’en France on appelle communément les garer. Cela a bien évidemment un lien avec les animaux (de trait ?) que l’on parquait, au parc donc.
Il est toutefois vrai qu’on parle d’un parc de stationnement en français (car park en anglais, et non “parking”). On voit cependant la définition suivante dans ce même TLF :
Parquer
3. Parquer (un véhicule). Arrêter et ranger (un véhicule) dans un parc, dans un emplacement prévu pour son stationnement. Synonyme – garer, stationner.
(Attesté depuis 1930 selon le TLF.)
Je ne me souviens toutefois pas avoir jamais entendu employer ce verbe dans ce sens en France. Qu’en diraient les Français venus se parquer momentanément sur Martian Spoken Here (un cul-de-sac) ?
Zerbinette, je reconnais le j’en ai marre, marabout … bien que je ne me rappelle plus tous les liens.
Siganus: coco(a)nut: cocoa en anglais veut dire « cacao » (un mot de la langue maya), mais il y des gens qui écrivent cocoanut au lieu de coconut pour la « noix de coco ».
« parquer une voiture »: ce n’est pas forcément l’équivalent de les garer: on peut garer sa voiture ou simplement se garer là où il y a de la place, devant sa maison ou sur le côté de la rue, mais pour la parquer il faut peut-être trouver un parc de stationnement. De toute façon le verbe parquer est sûrement un anglicisme.
On peut aussi parquer les gens aussi bien que les animaux. Par exemple, au cours des tempêtes qui ont fermé les aéroports européens il y a quelques semaines, les passagers en transit se sont retrouvés parqués dans les aérogares – pas prisonniers au sens légal mais le plus souvent sans moyens pratiques d’en sortir.
Marie-Lucie, je trouverais plus naturel de parquer des gens (animaux) que des voitures (machines). Naturel du point de vu de la langue. Mais si anglicisme il y a en ce qui concerne les automobiles, il doit être ancien, et il a obtenu droit de cité dans les dictionnaires.
Mais ma question était de savoir s’il arrive assez fréquemment d’entendre, en France, une phrase du genre “S’il vous plaît monsieur, parquez votre voiture derrière la banque”, ou “je vais me parquer là, sous cet arbre”.
Non, Siganus, en France ni « parquer » ni « parcage » ne sont employés couramment pour « garer » ou « stationner » pour la voiture. Même si les dictionnaires donnent ce sens (marqué comme néologisme dans le TLFi), il ne s’emploie pas dans le langage courant.
En agriculture, on emploie de moins en moins le verbe « parquer » pour la bonne raison qu’il n’existe pratiquement plus de parcs à bestiaux : ils sont le plus souvent à l’étable (on appelle ça « stabulation ») ou, plus rarement, en pâturage (« au pré ») avec une clôture matérialisée par un simple fil électrique.
Finalement, le seul élevage où l’on emploie encore assez souvent le « parcage » (et le verbe « parquer ») est … l’ostréiculture (et ses « parcs à huîtres »). En tout cas, c’est ce qui se dit sur l’étang de Thau qui, comme chacun sait, fournit les meilleures huîtres du monde, à Bouzigues.
Notre verbe “aparcar” (parquer) (plus usité que « estacionar ») est tiré de « parque », emprunté au français parc.
Jesús, dans mes bras !
Leveto, merci pour votre réponse (qui confirme mon intuition première, à savoir que “parquer son auto” constituerait un mauricianisme).
« en France ni « parquer » ni « parcage » ne sont employés couramment pour « garer » ou « stationner » pour la voiture » : Je n’ai pour ma part jamais entendu “parcage” ici, mais on peut imaginer que quelqu’un le dirait pour parler de l’action de (se) parquer.
Le verbe peut aussi bien être transitif qu’intransitif, la forme pronominale pouvant par ailleurs être employée. Exemples :
— Il a parqué sa moto sous un cocotier et un coco est tombé juste sur son speedomètre.
— Attends, je vais parquer là un coup et puis j’arrive. (Sous-entendu “je vais me garer là”.)
L’exemple ci-dessus pourrait aussi se dire à la forme pronominale :
— Attends, je vais me parquer là et j’arrive.
Le créole ne connaît pas l’usage du verbe pronominal (j’essaye de trouver un exemple montrant le contraire, sans y parvenir), ce qui fait que le “se garer” français, que d’aucuns traduisent en “se parquer”, tend à devenir intransitif (en devenant alors un équivalent de stationner), probablement sous l’influence du créole, d’où les formes équivalentes “parquer” et “se parquer”.
Bon, en Belgique, on parque aussi sa voiture. De même que l’on ne dit pas que quelque chose « marche », mais que cela « fonctionne ». Souvent, je me fais la réflexion que bien des mauricianismes sont aussi (ou pourraient être) des belgicismes (et dans le cas de *marcher/fonctionner*, on ne manquera pas, comme dans *stationner/parquer*, d’identifier l’influence de l’anglais).
Je me suis d’ailleurs fait la même réflexion en feuilletant récemment un petit livre assez drôle intitulé « Bretonnismes » où l’on retrouve de nombreuses « tournures » que l’auteur prétend dérivées du breton, mais que je suis sûr d’avoir déjà entendu ailleurs en France, voire en Belgique… ou sur cet excellent blog.
Sans être du tout linguiste, il me semble donc que souvent, ce qu’on appelle « régionalismes » (que la « région » soit la Bretagne, la Champagne, la Belgique ou Maurice…) sont plutôt des « archaismes » (i.e. les restes d’un français parlé il y a quelques siècles).
Sans être du tout linguiste, il me semble donc que souvent, ce qu’on appelle « régionalismes » (que la « région » soit la Bretagne, la Champagne, la Belgique ou Maurice…) sont plutôt des « archaismes » (i.e. les restes d’un français parlé il y a quelques siècles).
Aquinze, vous avez tout à fait raison. C’est vrai aussi pour le Canada, et cela affecte non seulement le vocabulaire mais la prononciation.
Il faut se dire aussi que le français ancien était plus diversifié que maintenant puisqu’il y avait moins de contacts entre les diverses régions, et entre celles-ci et la capitale, et les archaïsmes en question pouvaient être déjà des régionalismes.
en Belgique, on parque aussi sa voiture
Aquinze, dans mes bras !
Je trouve très amusant que nous partagions avec d’autres francophones des expressions qui ne sont pas utilisées dans la francophonie mainstream (si Monsieur Toubon veut bien me passer l’expression). Mais comment dirait-on au juste en Belgique ?
1. Je vais parquer mon auto là-même, près du mur.
2. Je vais me parquer là-même, près du mur.
3. Je vais parquer là-même*, près du mur.
(Les trois peuvent s’entendre à Maurice.)
Oui, vous avez probablement raison pour ce qui est des archaïsmes qui auraient continué à avoir cours dans des lieux assez peu “branchés”, i.e. des lieux qui sont peu en contact avec ce qui est à la mode dans les grands centres urbains d’où partent les nouvelles tendances. Quand on regarde dans le dictionnaire français, nombre de mauricianismes sont là, mais avec une mention “vieux”, “vieilli” ou “désuet”. Voir par exemple le billet précédent (Cousinages) dans lequel il est question de la bigaille. Mme Sutor dit souvent qu’elle “est chagrine”. A ce propos le TLF a ceci : « Chagrin, chagrine — Vieilli. Qui éprouve du chagrin, de la peine, qui est rendu triste pour une cause précise. Synonyme – affligé, attristé, contrarié, désolé, peiné, triste. » Il va sans dire que ce qui est un archaïsme pour certains peut être parfaitement contemporain pour d’autres. C’est un peu comme ceux qu’on appelle des “fossiles vivants” (e.g. le cœlacanthe), lesquels ne se sentent pas fossiles pour un sou.
Marie-Lucie, je présume qu’en Nouvelle-Écosse (et ailleurs aussi sans doute) on peut trouver grosso modo la même chose en anglais, non ?
* là(-)même : qui est-ce qui mettrait un trait d’union entre les deux mots et qui est-ce qui n’en mettrait pas ?