Pastor Benny Hinn
Holy Spirit
Miracle crusade
Anjalay Coopen Stadium
Mapou Mauritius
Sat, July 5 at 7 PM
Sun, July 6 at 4 PM
(230) 292-8770
Pastor Benny Hinn
Holy Spirit
Miracle crusade
Anjalay Coopen Stadium
Mapou Mauritius
Sat, July 5 at 7 PM
Sun, July 6 at 4 PM
(230) 292-8770
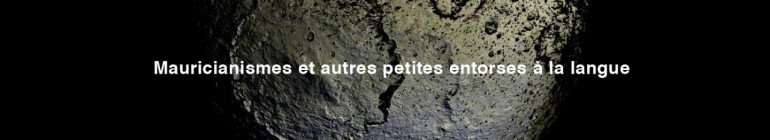

Oh, I had missed the specific website:
http://www.bennyhinn-mauritius.org/eng/index.php
« We are expecting God to do a great work at the Holy Spirit Miracle Crusade in Mauritius, scheduled for July 5 – 6, 2008. Believers have been praying for a powerful move there, and this is an appointed time, so we are especially looking forward to being there. »
(…)
« We see a strong unity among believers throughout the country, and people have been joining together in prayer for these meetings. »
(…)
« People throughout Mauritius are increasingly hungry for God’s power in their lives. »
I’m dead sure they are.
Ce n’est pas pour faire de la pub pour mon journal… le titre de l’article que l’express-dimanche avait consacré à Benny Hinn était… « Au nom du Père et du Fric »
http://www.lexpress.mu/services/archive-111425-religion-au-nom-du-pere-et-du-fric.html
« Il a aussi souligné le fait que plus on donne, plus le Seigneur nous le rendra. Bénir notre argent pour le faire fructifier. Je suis croyante, mais ce côté ‘donnant donnant’m’a beaucoup dérangée », explique Christelle Lebrasse, qui a assisté à la session de prière de Benny Hinn, dimanche. »
Google translate: « He also stressed the fact that the more you give, the more the Lord will make. Bless our money to make it grow. » I am a believer, but this side ‘giving donnant’m’a much disturbed, « says Christelle Lebrasse, who attended the prayer session of Benny Hinn, Sunday.
?????
Does this mean if you give money to Benny Hinn, God will give more money to you… or to Bennny Hinn?
In one of the Viking sagas, they decided it’s a bad idea to give to the gods in order to receive something, a better idea to give to the gods out of plenty because you have already received something.
> Rabin
Est-ce certain qu’il agit toujours au nom du Père ? Sur ses affiches (voir plus haut) et dans ses discours (voir son site web mauricien) il fait sans cesse référence à une autre personne de la Trimurti chrétienne, à savoir le Saint-Esprit (Holy Spirit), lequel ne se trouve manifestement pas qu’à Quatre-Bornes.
Le Saint-Esprit lui parle directement à l’oreille, mais pour le pasteur Toufik Benedictus Hinn la Trinité semble parfois pouvoir être élevée au carré : le site Info-Sectes.org, dans un paragraphe intitulé « Les enseignements hérétiques de Benny Hinn », indique qu’“en 1990, il déclara que la Trinité n’était pas composée de trois mais de neuf personnes !”
> Nijma
« Donnant donnant » could be translated as « fair’s fair » (i.e. « a fair deal », “I give you something and you give me something in return”). The person speaking said that she was being disturbed by the fact that there was such a « deal » with Benny Hinn, that it wasn’t just a matter of free offerings but looked more like a commercial transaction.
But, after all, is any offering to the gods, any prayer, always totally gratuitous? In the back of our mind don’t we mostly do it because we are looking for something — be it just a « general protection » — or because we want to say thanks for something that we previously longed for and that we finally got? See for instance the poster shown here: https://mauricianismes.wordpress.com/2009/12/11/ganesh-chaturthi-2009/
Pour beaucoup de ses adeptes il représente aussi bien le père, le fils que le saint esprit.
Je me souviens toujours du coup de fil d’une dame à la suite de cet article. Furieuse, presque blessée dans son âme, elle m’expliquait que même si elle est de condition modeste il était de son « devoir » de contribuer financièrement à l’oeuvre de Hinn. Ci dessous; son courrier paru dans le journal…et ma réponse laconique.
À propos de Benny Hinn…
Au commencement était la parole de Dieu.(…) Toutes choses ont été créées par la parole et la parole était Jésus. (…) Tous ceux qui croient en lui sont devenus enfants de Dieu. Il nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle à toute la nation. C’est pourquoi le pasteur ou le serviteur de Dieu sont appelés à faire le travail de Dieu. (…)
Il ne faut jamais critiquer un serviteur de Dieu. L’or et l’agent sont à Dieu. Nous sommes ses enfants et nous faisons ce que notre père nous a demandé. L’argent n’est pas un problème. Il faut aider notre pasteur pour tout ce qu’il fait. Il travaille nuit et jour pour aller prier pour les malades, ou pour les libérer du mauvais esprit. Il lui faut de l’argent, des voitures, des motocyclettes pour aller prier pour des gens. (…) Tous ceux qui ont donné, l’ont fait avec joie. (…)
J’aimerai rencontrer l’auteur de l’article « Religion : Au nom du père et du fric » pour lui expliquer ces choses parce qu’elle ne comprend rien. Il ne faut pas critiquer le pasteur. Que Dieu lui pardonne.
Lavnawtee LUXIMON
Le chanteur du groupe de rock Metallica, hurle dans « Leper Messiah », l’une de ses chansons : « Send me money, send me green. Heaven you will meet. » Si l’on pense atteindre aussi facilement le salut, c’est effectivement une grande preuve de foi…
R.B.
Il travaille nuit et jour pour aller prier pour les malades, ou pour les libérer du mauvais esprit.
This is dangerous and stupid, the idea that illness is caused by evil spirits and not by germs. If you look at Benny Hinn’s wiki page, you will see he is a faith healer and also a Pentecostal.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostalism
Pentecostals are way out there and some countries will not let them in ( I think Russia?). While the Holy spirit is a basic part of all Christian teaching (it’s in the Bible), the Pentecostals talk about Holy Spirit all the time; they are crazy about Holy Spirit, but only to make people emotional so they are easy to manipulate and take their money. I particularly loathe faith healers. In public they pretend to heal people very dramatically, but when investigations are done later, as they have been done with Benny Hinn, the people have not been healed, they are still sick, and now they have the heartache to learn of their illness a second time.
But, after all, is any offering to the gods, any prayer, always totally gratuitous?
No, at least, not according to the Bible, but I think it is human nature. For churches (like mine) that take the words of Jesus, and not the words of a pope as authority, the Lord’s Prayer is an example of how to pray: « Give us this day our daily bread »…. We are allowed to ask for material things, but bread, not cake, and sustenance for one day, not obscene wealth. My family also prays for weather: good weather for safe travel in the winter, and in summer, rain for the farmers. Some of the mainstream Protestant churches (that both Barack Obama and Hillary Clinton belong to) say that our purpose on earth is to be the eyes and hands of God.
http://archives.umc.org/interior.asp?mid=1686
That said, when I was in Katmandu I made a trip to the small Saraswati temple next to the small stupa behind the Swayambhunath temple where Nepali students like to visit before their exams. I wasn’t sure what form of offering she prefers, but I decided that gods everywhere accept money, so I made a small cash donation to her shrine. When I got my grades that semeter, I was not disappointed.
Je pense que la question de Sig est fondamentale : est-ce qu’il arrive jamais que nous donnions « gratuitement », c’est-à-dire sans compter, même au plus profond de nous-même, sur un « retour » ?
Ce serait enfoncer les portes ouvertes que de renvoyer à Mauss et à sa théorie du don et du contre-don, mais force est de constater que nul ne parvient à complètement échapper à la logique « rémunératrice » du don (la rémunération ne serait-elle qu’intime et strictement psychologique : donner porte en soi-même son propre « retour sur investissement »).
On peut sourire ou s’indigner des pratiques de ce pasteur soi-disant inspiré par l’Esprit Saint – ou quoique ce soit qui en tienne lieu. On peut les dénoncer, comme Rabin, essayer de dessiller les crédules qui se font plumer. Mais qu’avons-nous à leur offrir à la place ? Quel troc plus alléchant pouvons-nous leur proposer ? « Ne donnez rien, parce que vous ne recevrez rien en retour » – est-ce une alternative tenable ? Non, bien sûr que non.
Pour n’être point d’argent sonnant et trébuchant, le « don » a-t-il plus ou moins d’espoir de retour ? Non, bien sûr que non.
Alors, ce serait le caractère « monétaire » du don (et surtout l’absence de caractère monétaire du retour, autrement dit « contre-don »), qui signerait l’arnaque ? Oui, il semble bien que ce soit cela qui choque Sig et Rabin. Mais les sous servent AUSSI à cela, n’est-ce pas ?
Acheter ce pour quoi vous n’avez rien « de même valeur non monétaire » à troquer… pourquoi pas ? On sort juste de la période des « cadeaux » : comme chaque année, E-Bay a enregistré un pic de mise en vente le lendemain de Noël, cela prouve bien que le « don », in fine, se mesure de façon aussi précise que le décrit Mauss : c’est seulement en tirant x centaines d’euros de cette édition rare dont le vendeur n’a rien à cirer qu’il réalisera ce qu’il doit MAINTENANT à ce vieux pote bizarre qui s’obstine à lui offrir des vieilleries…)
A contrario, la lectrice de Rabin en a visiblement pour son argent, et il n’est pas surprenant qu’elle ait été choquée par son article : d’une certaine façon, je me demande si elle n’est pas plus heureuse – et plus pure – que le gars qui fourgue son édition ancienne sur E-Bay le 25 décembre… et surtout, au nom de quoi nous nous arrogeons le droit d’ironiser sur l’inutilité de ses dons. Même si Benny Hinn est un escroc.
Very interesting about Mauss. But is there a difference if someone gives you a present you don’t like and put on ebay and if someone gives you a wrapped box they know is empty? Or, as Sig’s title says, is the real payment the « show ».
Nijma, the post’s title was a reference to The Benny Hill Show, a show Martians used to like pretty much.
This is dangerous and stupid, the idea that illness is caused by evil spirits and not by germs.
This is what is believed in large parts of Africa. A Polish journalist who spent most of his career in Africa wrote an excellent book about the African society. In this book — translated as Ébène in French —, he said that, for a lot of Africans, if someone is ill it is not due to natural causes. It is due to a spell instead. I would really love to find and reproduce the passage where Ryszard Kapuściński talks about all this, but I gave my copy of the book to someone who, after Stockholm, is unlikely to come to my place again, I think. I should definitely order a new copy. This is a book that was praised by people as far away from each other as Jean-François Revel and Le Monde diplomatique. This belief in an evil spirit sent by someone wishing you harm is a good indication about the power « healers » can have in Africa. I don’t know how much our friend Benny Hinn went to Africa and how popular he may be there, but I would be tempted to think he’s got a lot of fans on the continent.
But is there a difference if someone gives you a present you don’t like and put on ebay and if someone gives you a wrapped box they know is empty?
I’d say yes, there is a difference. In the first case the person thinks you are going to like it. He or she wants to please you. In the second case it is just a joke. This why it is quite mean to sell a present you have received and that you don’t like. You’d rather give it to somebody else, which is something I have personally done, for instance after being offered books I didn’t like.
Aquinze, un don ne se mesure-t-il qu’à sa valeur marchande ? Ce qu’il coûte au donneur ne rentre-t-il pas en ligne de compte ? Si par exemple je vous donne les deux tomes de Dune que j’ai depuis mon adolescence — livres en format “Pocket” que j’ai lus et relus je ne sais plus combien de fois tant je les ai appréciés —, ce cadeau-là n’aurait-il pas une valeur relativement élevée bien que les livres en question, usés et jaunis, ne “valent” pas 10 roupies chacun ? Et que dire de quelqu’un qui “donne” de son temps à ceux qui en ont besoin ? On ne peut pas vraiment le chiffrer (disons que la personne le fait pendant son temps libre, free time en anglais, temps qu’elle aurait pu consacrer à bloguer ou regarder la forme des nuages), mais est-ce que votre Mauss — que je ne connais pas — le compte pour zéro parce qu’on ne peut pas mettre un prix dessus ?
Mais je suis bien évidemment prêt à convenir avec vous qu’un don appelle presque toujours une contrepartie, ne serait-ce que sous forme de reconnaissance. Il ne peut être totalement, complètement, intégralement gratuit. Imaginons que je vous envoie un livre que j’ai aimé. C’est un don, je veux vous faire plaisir, et je n’attends pas que vous me rendiez la pareille. Vous ne le faites pas. Quelques mois plus tard je vous envoie un autre livre, toujours gratuitement (“le plaisir d’offrir”, comme dit ce collègue qui, au bureau, distribue régulièrement des friandises à ceux qui partagent la même salle que lui). Même scénario que précédemment. Croyez-vous qu’arrivé au dixième livre je — un être humain moyen — ne vais pas commencer à trouver que, bon, je le fais certes “par goût du partage”, “par plaisir”, “de bon cœur”, mais que ça ne se passe finalement qu’à sens unique ? N’attendrais-je pas un retour, aussi minime soit-il, qui vienne équilibrer un tant soit peu nos “échanges” ? Combien de temps une personne “normale” (comprenons l’expression par “moyenne”) accepterait-elle de toujours donner sans jamais rien recevoir ? Il faut être un saint, véritablement, pour toujours donner sans jamais rien attendre en retour. Je ne suis pas certain que certains saints patentés, certaines personnes reconnues comme ayant réussi à se détacher des sentiments et ressentiments humains, aient réellement été capables de cela.
Ce serait enfoncer les portes ouvertes que de renvoyer à Mauss et à sa théorie du don et du contre-don
Ceci n’est pas sans me faire penser au potlatch des Amérindiens du Canada occidental, coutume qui consistait à faire des dons somptuaires destinés à affirmer son rang. Ce type d’échanges ritualisés, objet d’une cérémonie formalisée, fut interdit par le gouvernement fédéral canadien de 1884 à 1951. « Depuis la côte du Pacifique Nord, peuplée par des cultures avancées, vinrent une certaine préoccupation de la richesse et la division de la société en nobles, roturiers et esclaves ; de là vinrent également les clans et les moéties, imposant leurs règles en matière de mariage, d’héritage et d’obligations personnelles. Cette région légua aussi aux habitants du Plateau des danses masquées et un démon cannibale et persécuteur ainsi que l’institution du potlatch, qui consistait à se couvrir de gloire et à humilier son rival en le surpassant dans la générosité des dons effectués. » (Geoffrey Turner, Les Indiens d’Amérique du Nord, page 178.) Si je ne m’abuse, Marie-Lucie a vécu parmi les Indiens de Colombie britannique et elle pourrait être à même d’en parler bien mieux que moi qui n’ai lu qu’Alaska, de James Michener, et le livre cité plus haut.
Cela n’est pas sans me faire penser aux cadeaux qui peuvent être offerts pour un mariage : dans certains cas c’est là une façon de montrer qu’on a les moyens de donner des choses qui ont vraiment de la valeur. Le prestige en rejaillit ainsi sur le « généreux » donateur.
Pendant longtemps j’ai été un donneur régulier de sang, jusqu’à cette fois où, à l’hôpital Victoria de Candos, je suis sorti le linge couvert de sang à cause de l’amateurisme de l’infirmier. (Et puis je n’ai plus guère le temps d’y aller en semaine.) Quand je m’y rendais on me demandait en général « Pour qui vous donnez ? », car à Maurice chaque personne devant subir une opération doit au préalable « fournir » deux donneurs au centre de transfusion sanguine. C’est le moyen qu’a trouvé le corps médical pour tenter de reconstituer ses stocks de sang. Et à chaque fois que je répondais « Pour personne », je sentais comme un petit flottement. Les donneurs « volontaires » étaient semble-t-il loin d’être la norme. Et longtemps je me suis demandé ce qui me poussait à le faire, d’autant plus que ma mère tentait de m’en dissuader, arguant que je ne leur devais rien et que ceux en charge de ce service étaient des zigomars en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Sans doute en tirais-je une forme de gloriole, ou de satisfaction intérieure — car pour ce qui est du thé qu’on vous offre après… —, et cela m’a-t-il permis d’en parler un jour sur un blog…
Alors, ce serait le caractère “monétaire” du don (et surtout l’absence de caractère monétaire du retour, autrement dit “contre-don”), qui signerait l’arnaque ?
Oui, cela me gêne de voir des gens ne roulant manifestement pas sur l’or se dépouiller ainsi de leurs maigres ressources pour conforter la position d’un homme ayant l’art de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Si le don ne constituait qu’à offrir un coco, du beurre, un bâton de sandal, une bougie, de l’eau — bref quelque chose n’enrichissant pas matériellement celui censé recevoir l’offrande —, alors pas de problème, du moins tant qu’on reste dans des limites acceptables. Mais dès qu’il est question de biens qui peuvent être utilisés dans un but autre que celui auquel ils sont censés servir, alors je dis qu’il convient d’être prudent. Dans le cas des religions établies de longue date, je pense qu’il existe presque toujours des mécanismes pour contrôler et gérer les dons en espèces ou en nature (biens immobiliers par exemple). Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de malversation — certains prêtres, certains hauts dignitaires même, peuvent déraper —, mais en général il existe des garde-fous finissant par remettre les choses dans l’ordre. Lorsqu’il s’agit de religieux plus ou moins autoproclamés ou de mouvements religieux fraîchement établis, il est beaucoup plus difficile d’exercer un contrôle, l’État et son système judiciaire étant généralement le seul recours dans ce cas, un recours souvent ultime et tardif, quand il vient.
au nom de quoi nous nous arrogeons le droit d’ironiser sur l’inutilité de ses dons
A moins d’avoir été moi-même attaqué au premier abord, je n’ironiserai pas sur un don qui me semblerait être de l’argent jeté par la fenêtre, surtout si la personne me paraît vulnérable. Mais peut-être essaierai-je de lui faire prendre conscience de certaines choses. Quant à enlever toutes ses illusions à une personne n’ayant pas d’autre soutien moral que sa foi, je ne me sentirai pas autorisé à le faire. Il me semble avoir dit ailleurs, peut-être lors d’une discussion dans laquelle vous étiez impliqué, qu’un incroyant cherchant à enlever ses croyances à une personne n’étant pas en situation de vivre sans ce soutien-là ne serait qu’un salaud. Par contre, si au nom de ces croyances on « arnaque », comme vous dites, une personne ayant besoin des ressources qu’on lui prend, alors il me semble judicieux de neutraliser autant que possible la nocivité matérielle d’une telle démarche, quitte à faire l’impasse, autant que faire se peut, sur le côté spirituel de la question.
Rabin, le nom de la dame n’est pas de ceux qu’on associerait d’emblée avec une religion chrétienne. Il me semble qu’à Maurice les mouvements évangéliques* — ou Pentecostal comme le dit Nijma plus haut — ont le vent en poupe et ratissent aussi large que possible, avec un certain succès. Certes, il existe des Chrétiens qui ont des noms hindous — je connais par exemple un Rishi dans ce cas —, mais il me semble qu’un certain nombre d’Hindous ne sont pas sourds aux bruits que font les mouvements évangélistes*. Il se trouve que je suis passé par le rond-point de Plaine des Papayes dans l’après-midi du samedi 5 ou du dimanche 6 juillet. Eh bien il existait un embouteillage sur l’“autoroute” à cet endroit, à cause du nombre de personnes se rendant au stade Anjaly. Ces personnes n’étaient pas toutes de tradition chrétienne. Y aurait-il un « malaise religieux » dans notre joli pays ? Je le pense, et je pense qu’il s’exprime sous bien des formes.
* on se demande s’il faut employer l’adjectif évangélique ou évangéliste, si ce n’est pentecôtiste…
Il me semble que la seule façon de sortir du schéma don/contre-don dont parle Aquinze est le don anonyme fait à un inconnu.
Je m’explique :
Si vous donnez, comme le raconte Siganus, un objet quelconque à un ami, même si vous n’attendez rien en retour, cet ami sait votre don et vous savez qu’il sait. Vous en obtenez donc au moins de la reconnaissance (ou de la rancœur s’il ne peut pas vous faire un don équivalent) et donc un supplément d’estime de soi. Même les dons à un nécessiteux sont payés de retour, ne serait-ce que d’un sourire ou d’une certaine reconnaissance sociale s’ils sont faits en public ou par le biais associatif.
Le seul vrai don, à sens unique, est celui qui consiste à déposer dans un lieu public un objet quelconque — comme un livre sur un banc — en pensant que quelqu’un se l’appropriera; à ne pas s’en vanter; et à ne pas chercher à savoir qui en aura profité. Vous seul savez que vous avez donné et rien ne vous sera jamais rendu.
( C’est ce que je me dis à chaque fois que j’oublie mon parapluie dans l’autobus. Ça console un peu…!)
Sig, c’est précisément « mon » Mauss qui a popularisé le terme de potlach dont vous parlez .
Je ne sais pas trop comment, mais il se trouve que je posssède un exemplaire de la revue de sociologie dans laquelle a été publiée dans les années 1920 l’ « Essai sur le don » de Marcel Mauss. Je pensais vous recopier les passages de l’introduction sur cette notion de potlach, mais c’est fort long – et d’ailleurs, avec les « moyens modernes », je ne doute pas que vous puissiez le retrouver facilement si cela vous intéresse.
Leveto : pourquoi le don ignorant de son donataire, ce que vous appelez le don à sens unique, serait-il le seul vrai don ? A mon avis, dans un don de ce genre, il manque une composante essentielle, justement identifiée par Sig, qui est, au-delà de l’objet qui concrétise le don (dans votre exemple, le livre que l’on abandonne sur un banc public), le souci individualisé de faire plaisir au donataire, ce qui suppose qu’on le connaît, et que l’on s’efforce de le toucher, soit en se pliant aux codes en usage dans son univers, soit en chargeant ce présent d’un message secret qui ne sera peut-être pas déchiffré…
Un bouquin abandonné sur un banc qui finit dans la poubelle des services d’entretien des parcs et jardins de votre ville, vous ne pouvez pas appeler ça un don – spécialement si vous l’avez laissé là parce que vous l’aviez déjà en trois exemplaires, ou que vous le trouviez tellement nul que vous n’aviez de toutes façons pas l’intention de le ranger dans votre bibliothèque.
Et si au contraire, ce que vous avez laissé sur le banc est l’édition originale du premier tome d’ « A la recherche du temps perdu », vous ne ferez jamais croire que c’est un acte gratuit : certes, vous n’attendrez aucune compensation « matérielle » pour votre don, mais vous vous serez rempli l’âme d’une mine de réflexions si passionnantes (que vous les extériorisiez ou non…) qu’elles valent bien leur pesant d’euros…
Ryszard Kapuściński’s book was published in English as Shadows of the Sun .
In the second case it is just a joke.
So Benny Hinn is joking, knowing in advance his gift box is empty. He promises medical cures, but he can not deliver them.
I have seen this faith cure in Jordan as well. A Jordanian returned to Jordan after living in the U. S. for several years. His job in the U.S. was small, but in Jordan a little money goes very far. He was able to buy many things for his family and throw a big wedding party for his brother. At the party he had a headache. His mother had received the gift of healing some years earlier while praying all night during Ramadan. His mother took a kleenex tissue and stroked his head with it, while reciting from the Koran. Every once in a while she would twitch, as if something was coming out of him and going into her. Then she burned the tissue. The mother said the headache was caused by an evil eye put on him by the envy of someone. My friend did not believe it, but it was his mother, so what could he do? Afterwards he said, oddly enough, his headache was gone. I told him yes, it is the mother’s touch; my mother used to kiss an owie to make it well, and we would stop crying.
This family accepted Western medicine though. One son was in medical school and the mother got daily insulin shots.
ego : Je ne sais pas trop comment, mais il se trouve que je posssède un exemplaire de la revue de sociologie dans laquelle a été publiée dans les années 1920 l’ “Essai sur le don” de Marcel Mauss.
A dire vrai, j’ai envisagé de l’offrir à la copine d’un de mes fils, étudiante en sociologie. Finalement, je ne l’ai pas fait. Pour des raisons diverses, dont, au fond, je ne suis pas très fier – notamment le sentiment qu’ « elle ne se rendrait pas compte de la valeur de ce cadeau ». Ou encore qu’ « un étudiant en sociologie, de nos jours, ça ne sait même pas qui est Mauss ». Et même ceci : « De toutes façons, elle ne fait que passer. Elle m’oubliera plus vite encore que son amoureux du moment. »
Autant pour la gratuité du don.
Et le plus triste, c’est que cette vieille revue jaunie dont la couverture part en morceaux finira, au mieux, chez un bouquiniste, mais plus probablement dans un container quand mes fils videront ma maison après m’avoir collé dans une maison de retraite…
Vanitas vanitatum !
Il mes semble que la seule façon de sortir du schéma don/contre-don dont parle Aquinze est le don anonyme fait à un inconnu.
This is the way the Bible says to give to charity.
« Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que fait ta droite. »
http://scripturetext.com/matthew/6-3.htm
vous ne pouvez pas appeler ça un don – spécialement si vous l’avez laissé là parce que vous l’aviez déjà en trois exemplaires, ou que vous le trouviez tellement nul
Ah! Mais si! Quand je fais un don de dix euros à un mendiant, ce ne sont certainement pas les seuls dix euros en ma possession et en revanche, pour celui qui n'en a pas, ils ont une sacrée importance! Et si moi je n'ai pas aimé un livre, un autre l'aimera peut-être, non?
certes, vous n’attendrez aucune compensation “matérielle” pour votre don, mais vous vous serez rempli l’âme d’une mine de réflexions si passionnantes (que vous les extériorisiez ou non…) qu’elles valent bien leur pesant d’euros…
Oui, Aquinze, je suis d’accord. Mais faire un don de ce genre à soi-même est-ce encore un don ou n’est-ce pas plutôt un des nobles buts de la vie: se remplir « l’âme » ?
Ah! Flûte! Fâché avec les balises! Excusez-moi.
Leveto, je vous offre un débalisage, gratuitement !
A15 : “De toutes façons, elle ne fait que passer. Elle m’oubliera plus vite encore que son amoureux du moment.”
Autant pour la gratuité du don.
Ha ! ha ! Vous pouvez vous vanter de m’avoir fait rire. Du coup, vous m’avez même rafraîchi la mémoire à propos de certaines lectures de jeunesse : Amours sur le Don.
Bon, leveto, vous me faites réfléchir.
J’ai failli vous répondre, spontanément, que pour qu’un don soit un don, il faut qu’il vous coûte (ici, on admet une fois pour toutes que par « coût », on ne pense pas forcément « valeur monétaire »).
Et il est tout à fait clair pour moi que je n’attache pas la même valeur à un truc auquel je tiens mais dont je me sépare au profit de quelqu’un que j’aime (avec la probabilité non négligeable que ce « don », très précieux pour moi, perdra une partie de sa « valeur » en changeant de propriétaire), et un truc dont je ne sais pas quoi faire mais que je donne parce qu’il fera plaisir à quelqu’un qui aimerait l’avoir (avec la probabilité élevée que ce truc acquiérra de la sorte une « valeur » qu’il n’avait pas pour moi…).
Mais en réalité, c’est un peu plus compliqué que cela. Imaginons que je sache que vous ayez envie de quelque chose qui moi me laisse parfaitement indifférent, mais que, sachant que vous en avez envie, je me le procure pour vous l’offrir : le « don », dans ce cas de figure, ne tient pas tant à l’ « objet », mais à l’attention que j’aurais porté à vos goûts et à l’effort que j’aurais fait pour les satisfaire.
En d’autres termes (ô joies des enfonçages de portes ouvertes…), il existe deux mesures possibles du « don » : la « valeur » qu’il a pour celui qui donne, et la « valeur » qu’il a pour celui qui reçoit.
Si l’on en revient au cas de Benny Hinn, ce qui choque, c’est la disproportion entre la valeur du don côté donateur (cf la lettre de la lectrice), et l’absence de valeur côté donataire (puisque l’on soupçonne que le seul objectif de ce pasteur est d’arrondir son compte en banque) – ce qui nous ramène à l’exemple que je donnais de la revente des cadeaux sur E-Bay le lendemain de Noël.
Mais lorsque vous dites « ces 10 euros n’ont pas de valeur pour moi, mais ils en ont beaucoup pour le mendaint à qui je les donne », est-ce qu’il n’y a pas la même disproportion entre le don vu du côté donateur, et vu du côté donataire ? Pourquoi cela serait-il moins choquant ?
(J’ai conscience de patauger pas mal, dans cette affaire, et je prie Sig d’excuser ce soliloque assez confus – mais le sujet lui-même part dans tous les sens… )
Pour compliquer encore la chose, il faudrait cette fois se placer du côté de celui qui reçoit : j’ai souvent remarqué qu’un « don gratuit » est profondément déstabilisant. Et O. Wilde, baissant pour une fois sa garde de cynique, l’avait sans doute aussi remarqué lorsqu’il écrivait (je cite de mémoire, je crois que c’est dans La Ballade de Reading Jail ): « I am not ashamed of someting that is given to me by love and affection, I am proud of it ».